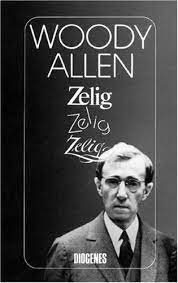


De Joseph Losey à Woody Allen, de 1976 (Monsieur Klein) à 1983 (Zelig), il n’y a qu’un pas, que l’on franchit aisément. Le grand cinéaste anglais qui a tourné ce grand et seul film sur la déportation, et plus spécialement l’ignominieuse Rafle du Vél d’Hiv, renvoie, à nos yeux, au seul cinéaste nord-américain qui, très souvent et dans beaucoup de ses films, a su parler du Juif de la diaspora, qu’il a mise en équation. Sans compter les nombreux gags juifs dont il a usé : ainsi, son personnage d’éternel névrosé dénonce-t-il l’antisémitisme d’un barman de self-service où, sur la base du Do it yourself, lui entend, en palatalisant à outrance le d initial, jew it… Rappelons que sous le masque de Woody Allen – qui sonne pour nous comme un nom de clown – se cache Allan Stewart Konigsberg, un enfant du Bronx entendant et parlant le yiddish de ses parents russo-autrichiens, et s’éduquant huit ans durant dans un heder de Midwood : un enfant totalement juif et instruit à la juive.
Son film Zelig est, à cet égard, éminemment parabolique. L’intention de Woody Allen, dans ce film-documentaire − dont on a surtout vanté la prouesse technique époustouflante, mêlant les prises de vue aux documents filmiques des années 20 et travaillant savamment le grain de la pellicule −, est de nous montrer un homme singulier, dont l’attitude « anormale » n’engage que lui, apparemment, un homme qui a le pouvoir de se transformer en mimant ce qui l’entoure et qu’on appelle homme-caméléon, mais aussi , en le stigmatisant au fil des séquences, lézard et reptile – la vermine de Kafka n’est pas loin, et d’ailleurs tout ici est affaire de métamorphose. Où qu’il se trouve, il s’adapte physiquement, et psychiquement, à l’autre et son environnement. Mêlé à des obèses, le voilà grossissant démesurément. Auprès de Colored men, le voilà noir, et il se trouvera même une femme de Harlem pour se prétendre son épouse, qu’il aurait abusée en se faisant passer pour le frère de Duke Ellington ! Et s’il est en compagnie d’Asiatiques, inévitablement, ses yeux vont se brider et son teint jaunir. De plain-pied avec les autres tout en étant à côté de la plaque.
Que signifie « Zelig », orthographié Selig en allemand ? rien de moins que « bienheureux », ou tout bonnement « heureux », glücklich, « qui a de la chance », ce pourquoi on trouvera aussi le patronyme yiddish Glicklich. Et tous les Zeligman – patronyme juif typiquement polonais − sont des gens vernis, pleins de bonheur et de chance!
Il s’agit pour cet homme ordinaire, le plus quelconque qui soit, un lambda, un zéro, un numéro tatoué, une ombre inaperçue, ainsi qu’il sied à tout immigré, et qui n’aspire qu’à se fondre dans la masse et à rester anonyme, alors même que l’anormalité de Zelig fait de lui dans les années 20 l’homme le plus célèbre d’Amérique. Le seul but de cet « heureux homme » est de trouver le bonheur, c’est-à-dire d’être aimé. La quête de la félicité est rivée au cœur du Polack, et le désespoir absolu, selon Albert Cohen qui s’y connaissait en tant que rédacteur du « Passeport Nansen », c’était d’être « un Juif polonais sans passeport » ! C’est pourquoi les Juifs du shtetl qui émigrèrent en France se passaient le mot, comme un sésame : Leben – ou men ist azoy ou glicklich − wie Gott in Frankreich, « Heureux – ou chanceux − comme Dieu en France » −, mais nous verrons comment Woody Allen déconstruit cette béatitude.
Qu’est-ce que la maladie de Zelig, qui mobilise tout ce que la psychiatrie et la psychanalyste comptent dans les années de l’entre-deux-guerres ? Au pays du melting-pot, elle pourrait être le désir maladif d’intégration au groupe majoritaire, s’il se définissait dans sa norme ; or il y a autant de groupes, de couleurs et de types que de familles d’individus : les Gros, les Noirs, les Chinois, les Juifs, les Mexicains, les Indiens…

Ce « caméléon », ainsi que le définit alors la presse américaine qui tire ses manchettes sur « The Changing Man », devrait, pour être dans le droit fil de l’inaccessible assimilation, choisir le moyen terme, le p.p.c.m. ou plus petit commun multiple… ce qu’il ne fait pas. Zelig est, en fait et successivement, tous les extrêmes et tous les particuliers de la société, toute la majorité et toutes les minorités en un vertigineux tour de face-face. On rappellera que le jeune Allan Konigsberg s’était rendu célèbre, à l’école et parmi ses condisciples, pour ses tours de passe-passe et de magie, dont il peuplera, d’ailleurs, maints films Ainsi, dans cette optique ludique, fera-t-il disparaître sa mère – l’inévitable, l’insupportable Mama juive − dans un de ses savoureux sketchs. Aussi Zelig est-il qualifié de « conformiste outrancier ».

Excessif, extrême, voire extrémiste, nous le retrouverons même « changé » en nazillon dans l’entourage d’Hitler − une des plus fameuses ou hilarantes séquences du film − parce que, nous dit-on, le fascisme lui apparaît comme l’option la plus accessible pour se fondre dans l’anonymat ! Idéologie de robots, d’ectoplasmes, de non-êtres… Toute une définition du Nationalsozialismus et de sa démente utopie.
Or voilà, ce personnage, qui se veut si ordinaire et si banal, est aussi défini comme juif. Non sans insistance. Un de ses numéros transformationnistes les plus réussis consiste, en France, à mimer des rabbins chapeautés à longue barbe et présentés comme de grands intellectuels − au point de passer pour l’un d’eux et de se retrouver, du même coup, sous la menace d’une déportation à l’île du Diable, comme Dreyfus, qui n’est pourtant pas cité : on fait toujours confiance au spectateur pour décrypter les multiples allusions ou clins d’œil et l’intertextualité du film.
Woody Allen, à cet égard, n’a pas attendu l’actualité douloureuse et quotidienne du début du 3ème millénaire pour sanctionner et railler le vieux fonds d’antisémitisme viscéral de la France. Est-il besoin de rappeler que c’est l’affaire Dreyfus et la cabale d’alors contre les Juifs qui détermina le journaliste viennois (né hongrois) Theodor Herzl, venu couvrir ce procès, à écrire L’État des Juifs, et, en énonçant la phrase décisive : « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve », à mettre véritablement sur les rails le mouvement sioniste ? Oui, d’une certaine façon, on peut dire que la France − qui n’a plus l’air de s’en soucier ni de s’en douter − est, dans ses travers, responsable au premier chef de la création de l’État d’Israël… avant de devenir aujourd’hui, par sa stigmatisation (nolens volens) des Juifs, le pays le plus pourvoyeur d’alyas. Shimon Peres le savait bien et n’en fit pas mystère, lui qui vint quêter et obtenir en France les armes décisives – les fameux Mirages volants qui n’étaient pas un mirage, mais pas seulement si l’on en croit la liste établie par Michel Bar Zohar : Mille lance-roquettes, cent chars AMX 13, quarante obusiers automoteurs de 105 mm ainsi que les premiers avions à réaction produits par Dassault : soixante Mystère IV-A autant de biplaces Mystère IV-B, vingt-quatre Ouragan. Et encore douze Vautour fabriqués par la SNCASO, etc… – auprès de Guy Mollet qui, phrase ou phase décisive, osa même dire, au grand dam de Nasser : « Je leur dois la bombe ! ». Après quoi, Charles, le Grand Charlatan, dénonça cet amour partagé et brisa durablement les liens officiels entre le Quai d’Orsay et Israël, en anathémisant les Juifs globalement jugés « peuple d’élite, sûr de lui et dominateur », ce qu’illustra, en magnifique douleur, le génial caricaturiste Tim (Louis Mitelberg), se haussant à la hauteur de Woody Allen, maître en autodérision :

Juif, donc, Zelig est assurément un être inauthentique, vidé de toute substance, prêt à tout pour se faire accepter et aimer, et, bien entendu, prêt à trahir son hypothétique essence – dans un film, ce névrosé tente de rompre avec le judaïsme en s’essayant à d’autres religions : le catholicisme, le bouddhisme… en vain. C’est une coquille vide, un miroir qui ne renvoie qu’à l’autre : à cet égard, traité par le Dr. Fletcher, la psychiatre, il n’hésite pas à renverser les rôles et à prétendre qu’il est, lui, docteur, et elle sa patiente. Il est aussi ce que les autres, s’imagine-t-il, veulent qu’il soit : Être en diaspora, sans attaches ni liens ni tradition ni religion. Demande-t-il à un rabbin le sens de la vie ? ce dernier lui livre la réponse, mais en hébreu, langue qu’il ne comprend pas, ce qui donne lieu à cette blague typiquement juive : le rabbin facture à 600 dollars ses leçons d’hébreu non profitables ! Its’ a jewish joke.
Zelig est profondément « déconstruit », un mot qui doit moins à Derrida qu’à Saul Bellow, comme le sera plus tard le personnage de Harry (Harry dans tous ses états, traduction imparfaite du titre original et beaucoup plus parlant : Deconstructing Harry). Voilà, il est « flou », il passe difficilement à l’image, il est d’ailleurs souvent méconnaissable, voire peu reconnaissable : est-ce vraiment lui en Mexicain d’un orchestre de Mariachis ? Est-ce encore lui sous la casquette de militant nazi ? Le cinéma, plus que les autres arts, se prête à cette définition de l’être dispersé − diasporique −, parce qu’il procède par succession discursive d’images. Chaque séquence présente le personnage qui nous apparaît progressivement sur − ou sous − toutes ses faces. Comment ne pas penser alors qu’en hébreu, cette langue que Woody Allen − ou son personnage − avoue ignorer, le visage est toujours exprimé au pluriel : panim ? Le cinéaste, à son insu peut-être, bâtit un film qui est la glose de ce mot si « singulier » de la langue hébraïque, dont la première occurrence se trouve dans l’épisode de Caïn, dont l’offrande n’est pas du goût de l’Éternel, ce qui fait que son visage − toutes ses faces − tombe, et qu’il a l’air abattu – yipelou panaïv יפלו־פניו −, avant d’aller abattre son frère. Les différents visages de Zelig seront peu à peu dévoilés par la psychanalyste, dans le sillage de l’école freudienne et de ce Sigmund dont les illustres prédécesseurs s’appelaient Joseph et Daniel, les Voyants lumineux de la Bible.
Je me rappelle ici cette autre parole éclairante, d’un homme qui, lui aussi, avait le don visionnaire, le rabbin Léon Yehouda Ashkenazi (1922-1996), connu sous son surnom de Manitou qui lui venait des Éclaireurs Israélites de France, si grande était son habileté à manier concepts et idées. Il regardait en arrière le périple du peuple juif de la golah, et la migration des multiples visages de la diaspora, il les comprenait et les justifiait au nom de cette dispersion des Juifs écrite dans le Livre. Comme si les douze enfants de Jacob étaient partis pour un long voyage dont ils revenaient les poches pleines et la tête tourbillonnante, le sel de la terre aux semelles. Voilà, disait-il, vous êtes tous sur le retour, en chemin vers votre maison, celle d’Israël, qui est le prénom transfiguré de Jacob, notre père. Vous étiez, vous êtes des Juifs, mais maintenant, ou demain, vous serez des Hébreux et recomposerez le manteau déchiré du patriarche, le rideau du Temple[1]. Cette vision messianique renvoie à celle qui fut formulée par Isaïe le rassembleur − car si Jérémie se lamente sur le chaos, que nous appelons aujourd’hui, par une sorte de métathèse, Shoah (שואה catastrophe), et Ézéchiel le visionnaire aperçoit des chariots de feu dans le ciel, et l’incandescente Parole en marche, c’est Isaïe qui voit les routes de l’exil s’aplanir et s’effacer, et le peuple de Dieu converger vers le lieu de promesse. Prophète du miroir brisé et des vases recollés, Isaïe est le véritable porteur d’espoir et le prédicateur du retour. La Babel où le peuple juif a vécu se lézarde et s’effondre en dispersant ces pierres qui jalonneront le chemin jusqu’à la Maison, qui est, en hébreu, בית Baït, première lettre de la Torah et de Berechit (« Au commencement »).
Eh bien ! notre Zelig dont le nom est inscrit à la dernière lettre de l’alphabet romain et diasporique, a bien du chemin à faire pour rejoindre sa Baït, sa maison primordiale, mais il y parviendra bien à la fin du film et de la cure, grâce à l’amour, et alors là, oui, sera justifiée la pleine étymologie de son nom : le Bienheureux. Sauf que cette Maison ne sera pas la maison d’Israël, le tout n’étant, en fait, que gag de clown juif au visage triste. Ou parcours de névrosé qui soigne les traumas de son enfance en suivant des yeux sa psy maternelle : retour matriciel ?
Woody Allen est sans doute trop intelligent et intellectuel − bien qu’il s’en défende en alléguant son goût primordial pour le base-ball (« on n’y comprend rien, mais quel beau spectacle ! », entend-on dans le film) − pour accepter un tel raisonnement sur son film. Il est vrai, néanmoins, que ce film, parce qu’il est clairement parabolique et que la dimension juive n’en est à aucun moment occultée (« Qu’on le lynche, ce sale youpin », dit lors d’une séquence de radio une gardienne de la vertu puritaine, typiquement WASP), se prête à toutes sortes d’interprétations sur l’identité, et au premier chef l’identité juive. Le Juif y apparaît systématiquement rejeté de partout : pour le parti des travailleurs, il est l’odieux capitaliste suceur du sang prolétarien, et à l’inverse, pour l’extrême droite, il est l’agent de la révolte ou de la subversion ouvrière. On reconnaît bien là ces deux visages de l’antisémitisme historique : la haine du judéo-bolchevisme et la haine du judéo-capitalisme. Est-ce vraiment trop tirer ce film vers la mise en question de l’être en exil, aux visages éclatés, et du Juif inauthentique à l’être déconstruit ? En fait, pas un seul film des débuts du cinéaste qui ne soit marqué par la judéité du réalisateur, fût-ce sur le mode cocasse − comme dans Prends l’oseille et tire-toi, où le voleur amateur qui s’est fait prendre et purge sa peine de prison se retrouve à la chapelle (chrétienne) et, pour faire comme les autres, le voilà priant… sauf qu’il se balance d’avant en arrière, daven, daven, comme devant quelque Mur des Lamentations ! D’ailleurs certains antisémites ne s’y sont pas trompés qui ont vu en Woody Allen « un parfait exemple et un témoignage vivant du système juif et sioniste »[2]. Rien ne nous empêche alors d’en dégager, comme état pathologique patent, un « complexe de Zelig », selon lequel le Juif de la diaspora est désormais − désormais parce qu’Israël existe en État depuis plus de sept décennies (14 mai 1948) et qu’il en perçoit les clameurs et la corne du chofar rassembleur − un handicapé ou un malade. Malade de tous ses visages et ses masques qu’il n’a plus la force d’assumer et dont il se défera peu à peu, avec l’aide de l’analyste − du rabbin ? − jusqu’à aboutir, peut-être, à cette face unique qui le restituera en son être authentique, l’Hébreu, dont parlait le philosophe et rabbin Ashkenazi. Alors là oui, les propagandistes antisionistes l’ont bien vu : Zelig pourrait bien être un subtil plaidoyer pour le retour à Sion, et Woody Allen un étrange et efficace Chaliyar ou messager de l’État d’Israël. Le complexe de Zelig, au terme d’un parcours burlesque énonçant les ratages successifs de la diaspora, serait alors résolu par la loi du retour.
Sauf que le personnage de Zelig reste l’impayable New-yorkais frileux que l’on sait, un homme de diaspora et qui n’en démord pas. Entouré de ses deux parrains dans le film, Bruno Bettelheim, psychiatre pour enfant psychotique, et Saul Bellow, qui fait dire à son Herzog : « Plus les individus sont détruits, plus grand est leur désir de se rattacher à une collectivité », il restera donc cet être fantasque, contradictoire, un peu demeuré, foncièrement névrosé, un bipolaire en somme, aspirant à se fondre dans la masse et capable d’agir seulement sous hypnose en atteignant à un semblant d’intégration et de normalité par le seul effet du regard amoureux de la psychiatre avisée qui prend soin de sa personne. Ah ! oui, il ne voulait qu’une chose, être aimé, eh bien ! le voilà comblé − miracle de l’amour ! − sans plus se poser de questions.

Même si le spectateur, lui, doit continuer à s’en poser en son for intérieur. Désormais c’est à lui, en possession de toutes les cartes du Je et disposant de cet incomparable miroir de l’histrionisme juif, de se poser les questions essentielles : qui suis-je et qu’en sera-t-il ? Où suis-je et où me conduit-on ? Et, pour tout dire, la question fondamentale : qu’est-ce qu’un Juif ?
En vérité ce fameux « cinéma parlant », dont on sait désormais qu’il fut une invention juive − et l’on ne manquera pas de lire l’époustouflant ouvrage de Neal Gabler, Le royaume de leurs rêves.- La saga des Juifs qui ont fondé Hollywood (Calmann-Lévy, 2005), dont la thèse entend prouver, non seulement la création du cinéma hollywoodien par une poignée de Juifs originaires d’Europe centrale, mais aussi l’invention, par quelque visée ou vision messianique, du fameux « rêve américain » qui n’eut réellement d’existence qu’à l’écran et sur la pellicule, illusion pure −, nous propose des images qui parlent, qui interrogent et répondent à nos sempiternelles questions. On pourrait presque parler de leçon talmudique. Annulant les chambres noires par les idées claires.
[1] On trouvera cette idée exprimée, notamment, dans l’article « Je suis Juif, mes enfants sont Israéliens, mes petits-enfants sont Hébreux », repris dans Léon Ashkenazi, La parole et l’écrit. II.- Penser la vie juive aujourd’hui, Albin Michel, 2005, p.172-174. Citons la phrase essentielle de cet article : « Il est à nouveau possible et même nécessaire qu’un Juif redevienne un Hébreu et seulement un Hébreu ».
[2] Cité dans L’Arche, septembre 2004.
© Albert Bensoussan

Publié par brzustowski dans https://terre-des-juifs.com/
Ce site traite de l’actualité et des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la société israélienne et de la diaspora juive


Poster un Commentaire