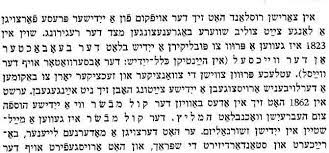
J’ai remarqué que lorsque je m’adresse à mes enfants en russe, j’utilise des mots inhabituels chez les russophones. Pourtant, cette culture et cette langue, je les ai bues avec le lait de ma mère. Je ne m’interrogeais pas plus sur ces mots avant d’entendre les chansons de Hava Alberstein chantées en yiddish (en particulier, A tale of woe about a Jewish King).
C’est là que je me suis rendu compte que ces mots « bizarres » étaient du yiddish. Le yiddish n’était pas à l’honneur dans notre milieu émancipé, qui le considérait comme une langue du shtetl, une langue de gens mal instruits et pas raffinés. Même si certains mots en yiddish émaillaient des blagues, les grands parents ne le parlaient pas (on ne savait pas qu’ils le connaissaient). C’est en mourant que ma grand-mère, qui parlait couramment le français, l’anglais et l’allemand en plus du russe, s’est mise à parler en yiddish, (juste avant de fermer les yeux).
Alors comment s’est faite la transmission ? Beaucoup de travaux ont été écrits, sur cette transmission inconsciente ou semi-consciente. Il sera difficile de les citer tous. J’ai lu récemment celui de Gassan Gusseinov, un philologue russe contemporain, qui parle de cette « langue maternelle inconnue jusqu’à la fin des temps ». Il construit son raisonnement à partir du livre de deux slavistes américains, originaires de Russie, Boris Bricker et Anatoly Vishevski Nous ne parlons pas yiddish, publié en russe en 2021.
Voici mon adaptation de son texte publié ici :
« Certains se demandent pourquoi les gens ont besoin de toutes ces petites langues parlées par des ancêtres ou des parents éloignés dans un trou perdu. Même dans le quartier d’à côté. Nous devrions apprendre les langues du monde, qui ont des millions de locuteurs. Il y a une certaine logique dans tout cela, bien sûr. Mais il arrive parfois qu’on n’utilise pas les langues du monde mais le langage intérieur.
Mais ce n’est qu’un préambule. Il n’y a pas beaucoup de temps, et nous devons passer au point principal. Et l’essentiel est que de nombreux peuples, y compris ceux dont les langues sont devenues des langues mondiales, ont parmi leurs nombreux griefs à l’encontre des Juifs celui-ci : les Juifs maîtrisent trop bien leurs langues mondiales. Pour certaines personnes, c’est exaspérant. Par exemple, tout le monde en Russie n’apprécie pas le fait que Ditmar Eliashevich Rosenthal soit devenu la principale autorité en matière de grammaire russe pour le commun des mortels ; les mêmes revendications ont été formulées à l’encontre des universitaires allemands et des écrivains d’origine juive en Allemagne dans la première moitié du vingtième siècle. Pourquoi deviendraient-ils russophones ou germanophones? Ne pourraient-ils pas vivre avec leur propre langue et rester à l’écart du monde. Mais les Juifs s’acharnent et continuent à écrire et à parler dans des langues qui leur sont totalement étrangères et ils reçoivent même des prix Nobel de littérature. En 1966, deux écrivains l’ont reçu pour des « thèmes juifs », comme on disait à l’époque en URSS : Nelli Sachs et Shmuel Agnon. Sachs écrivait en allemand, Agnon en hébreu, bien que dans sa jeunesse il ait également écrit en yiddish, une merveilleuse langue « germanico-slavo-juive ».
Le yiddish est apparu au Xe siècle en Europe centrale et orientale et s’est répandu des siècles plus tard, après l’invasion de la Pologne par l’Empire russe, comme langue séculaire commune des Juifs dans ce qu’on appelle le Shtetl. Lorsque l’Union soviétique a envahi la Bessarabie et la Bukovine en 1940, le yiddish y était également une langue vivante, il était parlé par des centaines de milliers de personnes. En 1944, cependant, la plupart de ceux qui parlaient yiddish avaient disparu : ils avaient été exterminées par les nazis.
Bien sûr, tout le monde n’a pas été exterminé. Mais pour ceux qui sont restés et ont survécu en Europe de l’Est et en Union soviétique, l’apprentissage d’une autre langue était au programme – l’anglais pour ceux qui rêvaient d’aller en Amérique, l’hébreu pour ceux qui rêvaient d’Israël. Entre-temps, la vie a continué, et ceux qui avaient été longtemps tenus à l’écart du Moyen-Orient ou de l’autre côté de l’Atlantique ont vécu leur vie heureuse là où le monde de l’après-guerre les a rattrapés. Mais le yiddish, la langue dans laquelle les journaux et les livres étaient imprimés avant la guerre, et les pièces jouées dans les théâtres, est devenu la langue des conversations familiales tranquilles dans la cuisine ou devant les enfants, de sorte que ces derniers ne comprenaient pas ce dont parlaient leurs aînés.
Les enfants ont grandi, et se sont dispersés loin de leur ville natale. Et les deux garçons dont je voulais vous parler, deux garçons, Boris et Anatoly, ont grandi dans le Tchernovtsi soviétique. Plus précisément, à Tchernovitsi, comme la ville était appelée par ceux qui se souvenaient de son passé autrichien, ou les vrais Tchernivitzer, dont la première langue maternelle était l’allemand. Ceux dont la première langue maternelle était le yiddish sont venus à Tchernovtsi après la guerre – certains de Bessarabie en rentrant de l’exil du Kazakhstan et d’ailleurs, et leurs glorieux descendants et mes héros, Boris et Tolik, ont émigré de Tchernovtsi aux États-Unis en 1980, où ils ont réussi à passer à leur nouvel anglais américain. Pour être précis, là-bas, en Amérique, ils ont étudié la littérature russe, approfondissant et élargissant insidieusement leur connaissance de la Russie dans leur première langue – le russe – et ils sont même devenus professeurs dans des universités américaines. Ils ont soutenu leurs thèses sur le comique, l’ironie, l’anecdote et l’humour, ou dans un domaine qui n’est accessible qu’aux locuteurs de leur langue maternelle. Le russe était leur langue maternelle, comme c’était le cas de la majorité des juifs de Tchernovtsi dans la seconde moitié du vingtième siècle. Bien sûr, il y avait aussi ceux pour qui l’ukrainien est devenu langue maternelle. D’ailleurs, de telles personnes vivent aussi en Amérique – avec trois langues maternelles – le russe, l’ukrainien et l’anglais. Mais, me direz-vous, quel est le rapport avec le yiddish ?
Au bout d’un demi-siècle, Boris et Anatoly se sont rendu compte qu’ils avaient une autre langue maternelle, dont la compréhension leur avait été inculquée dès leur plus jeune âge, bien qu’ils ne pussent pas et ne puissent toujours pas la parler eux-mêmes. Ai-je dit « compréhension » ? Peut-être me suis-je trompé. Le livre de Boris Briker et Anatoly Vishevsky s’intitule « We Don’t Speak Yiddish » : Nous ne parlons pas yiddish. Il a été publié en russe par la maison d’édition ukrainienne Meridian Czernowitz en 2021. Il s’agit des mémoires d’un monde dans lequel le yiddish était parlé et pensé par des personnes encore en vie. Mais ce livre parle aussi d’autre chose : cette langue a enseigné à Boris et à Anatoly comment supporter l’existence dans leurs deux langues vivantes (le russe et l’anglais). Comment fuir les coups d’une gravité parfois déprimante ou adoucir ceux qu’il est impossible d’esquiver. Quarante ans plus tard, Bricker et Vishevsky sont retournés à Tchernovtsi et ont reconstruit leur monde des années 1960-1970 à travers le prisme du yiddish.
Pour les Américains de la fin des années 1960, Leo Rosten a écrit un livre similaire, The Joys of Yiddish. Mais le livre de Bricker et Wiszewski est bien plus important et significatif pour ceux à qui cette langue procure ce qu’on appelle l’intelligence émotionnelle, une distance ironique qui tient chaud sans brûler, poignarde sans percer, mais vous remémore votre passé – et de celui de votre famille – chaque jour. Et pour comprendre l’histoire. Notre histoire est, bien sûr, « azokhn vei », mais vous devez aussi la comprendre. Vous pouvez donc deviner comment cela se passe : Boris et Anatoly ne parlent ni ne lisent le yiddish ; deux ou trois cents mots ne comptent pas. Et pourtant, ce yiddish, cette fine couche de travail entre le russe et l’anglais les aide à survivre entre, excusez la comparaison anatomique, les deux hémisphères. Une langue maternelle inconnue ».
© Yana Grinshpun


Linguiste, analyste du discours, Maître de Conférences en Sciences du Langage à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle UFR Littérature Linguistique Didactique, Yana Grinshpun est particulièrement intéressée par le fonctionnement des discours médiatiques et par la manière dont se présentent les procédés argumentatifs dans les discours de propagande. Elle co-dirige l’axe “Nouvelles radicalités” au sein du Réseau de Recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA)


Bonjour et merci !
je viens de lire avec grand intérêt, et émotion, votre ‘article, recension-traduction-“appropriation” concernant le Yiddish. Et la théorie de Boris et Anatoly.
Je voudrais faire, ici en toute modestie et surtout toutes proportions gardées, toute comparaison victimaire exclue, un parallèle avec “notre” ladino/judéo-espagnol/’hakitía (marocain). Espagnol ancien, (d’avant l’amuisemant du “F” en “H” de forno, farina… et la transformation du “X” en “J-ota”de xabón, caxa…) emporté dans les bagages de l’expulsion. Et dont ma grand-mère a bercé nos oreilles. Et que j’ai, en partie, retrouvé les éléments d’explication linguistique lors de mes études… d’Espagnol (tiens, tiens !) DEA et 2 tentatives d’agrégation !!!. Mais aussi, avec, en prime licences d’Italien et d’Anglais ! (Bien après des études initiales de commerce..!) Ah, les langues !
Merci de votre commentaire, j’ai eu le bonheur d’entendre en Israël les gens de ma génération garder des bribes de haketia (c’était essentiellement des Juifs marocains, d’autres qui parlaient des variantes de ladino un peu différents, venus de Turquie). Il y a des spécialistes qui étudient le parler judéo-espagnol, et il y a des linguistes qui se consacrent spécialement aux parler différents (notamment, haketia intéresse beaucoup les hispanophones. J’ai écouté des conférences sur cette langue dans le cadre des séminaires de linguistique hispanique, justement). Mais c’est un héritage qui peut se perdre si on ne le maintient pas, si on ne le cultive pas.