
Un certain nombre de nos contemporains ont sans doute encore en mémoire la grande somme intellectuelle de l’Histoire de l’antisémitisme, à laquelle son auteur –Léon Poliakov (1912-1995)- consacra un quart de siècle d’une recherche patiente[1]. Il est incontestable que cette contribution majeure, élaborée dans l’esprit de l’École des Annales de Lucien Febvre et Marc Bloch, ouvre un champ de compréhension inédit sur le phénomène antijuif. Appréhendée justement sur la longue durée, cette contre-histoire, comme aimait à l’appeler son auteur, a ouvert la compréhension de la civilisation à un objet qui n’était jusqu’alors étudié que de manière partielle. C’est le mérite et la valeur unique de cette exploration minutieuse de percer au jour les logiques de la judéophobie, ses postulats, ses implications, et surtout son importance structurelle.
Ce que montre l’historien, c’est avant tout le caractère d’invariant du rejet, de la discrimination et de la persécution de l’élément juif tout au long du développement de la civilisation occidentale mais aussi orientale. Cette logique de rejet se conçoit comme la conséquence d’un montage dogmatique : théologique, politique, juridique, idéologique. La prémisse antijuive, déjà présente dans l’Antiquité pré-monothéiste, du fait de l’étrangeté du message hébraïque (création, révélation, personnalisme éthique, refus de la divinisation du cosmos, sens de l’histoire, etc.) se justifie par suite de la relation polémique que le christianisme et l’islam instaureront en regard de la première Alliance : accusé de déicide par le premier, soupçonné de falsification par le second, le judaïsme devra se défendre contre cette double incrimination jusqu’à l’essor de la modernité séculière.
Poliakov aura contribué à identifier par le menu les schèmes de criminalisation de l’élément juif, au-delà de ce qu’il appelle l’Âge de la foi, dont l’Àge de la science pérennise les matrices. Il fut le premier à fonder la distinction antijudaïsme théologique/antisémitisme politico-culturel, en décrivant les mécanismes de transformation des motifs-souches, à l’œuvre dans le passage du premier au second.
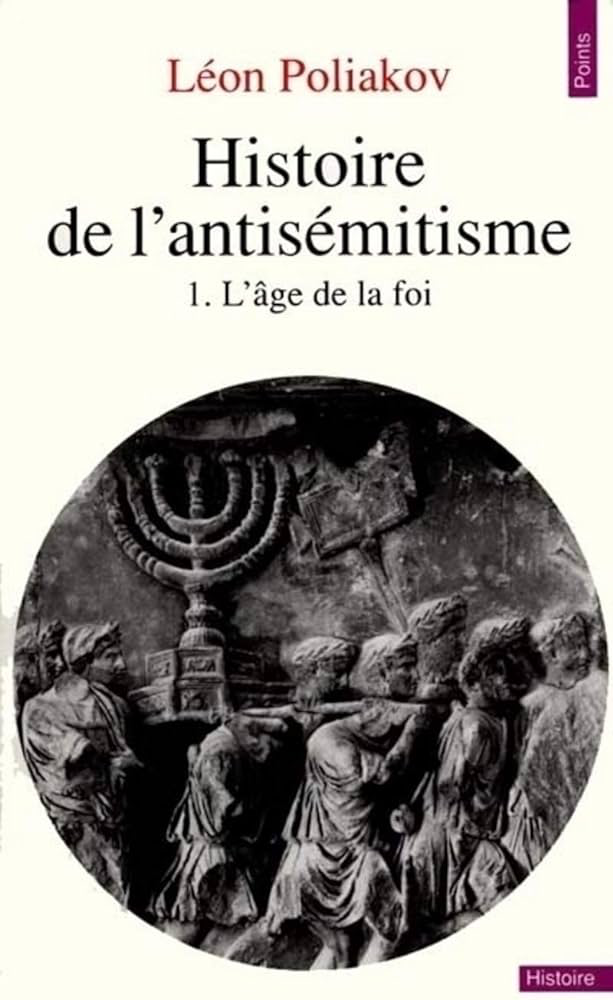
Il fut aussi le premier historien à conférer un statut majeur à l’histoire des discours, en tant qu’ils contribuent à délimiter les époques historiques, ainsi qu’à façonner les mentalités en fixant durablement la ténacité des préjugés. Les préjugés médiévaux notamment, que la modernité, la post-modernité et l’hyper-modernité n’ont eu de cesse de remanier et d’adapter aux conjonctures historico-politiques les plus diverses (le crime rituel, l’assassinat des enfants, la traîtrise, l’usure, l’esprit du secret, le calcul occulte, la pratique de la brutalité, le mépris de l’éthique et du droit).
Les analyses complémentaires que L. Poliakov a également consacrées aux manifestations récentes de l’antisémitisme, à partir du tournant de la Révolution Française jusqu’à la déflagration du racisme nazi, en font aussi, bien avant les grands travaux de Raoul Hilberg[2], le premier historien de la Shoa (Le bréviaire de la haine. Le IIIè Reich et les Juifs[3]). Avec son ami Norman Cohn[4], qu’il traduisit en français, L. Poliakov fut aussi pionnier en repérant l’importance croissante de la théorie du complot, dans l’incrimination de certaines minorités, et particulièrement dans le processus politique constant de criminalisation du peuple juif (La causalité diabolique[5]).
Le grand apport de cette nouvelle historiographie, dont les réalisations ont beaucoup contribué à étayer le domaine émergent de la psycho-histoire, consiste notamment à avoir établi, à travers la construction d’une contre-histoire occidentale –mais pas seulement- la cohérence de l’archive judéophobe. Cette archive ne consiste pas seulement dans l’intrication de séries évènementielles avec les séries discursives qui leur sert de justifications. Son exhumation et son analyse attestent de l’existence d’un ensemble d’invariants au long cours : la dialectique de l’incrimination/criminalisation du signe juif, et des modalités qu’il recouvre (le judaïsme, les Juifs, Israël) ne représente pas seulement un épiphénomène, ni une somme de conjonctures sans lien les unes avec les autres. Bien au contraire : pour les producteurs de l’imaginaire antijuif, sa constance résonne comme l’expression négative d’une image de soi. La judéophobie se caractérise par le fait d’objecter aux Juifs leur judéo-centrisme égoïste, et partant, leur présence à l’histoire ainsi que leur vision du monde prétendument nuisible. Ce faisant, cet éternel procès apporte au moins une certitude : le rejet et la stigmatisation, dogmatique ou violente des Juifs, définit un principe d’identité. Cela nous fait comprendre que la fixation antijuive est un judéocentrisme négatif, sans laquelle il manquerait quelque chose à la raison d’être des nations. Cela est sans doute déplorable, mais cette part de négativité, que les prétentions des différentes idéologies du salut ou du progrès n’ont jamais éliminé de leur dynamique interne, éclaire le fond primitif de la disposition judéocide. Se poser en se posant, s’affirmer en s’idéalisant et simultanément en dégradant l’ennemi invariablement désigné.
Les résultats scientifiques de l’Histoire de l’antisémitisme ont fait apparaître le caractère à la fois permanent et adaptable du motif comme du mobile antijuif. À elle seule, cette contribution eut suffi à faire école. Mais l’acuité de jugement acquise par ce premier accomplissement disposa L. Poliakov à ne rien abdiquer de sa vigilante observation. Dès la fin des années soixante, il s’imposa de prolonger ses analyses en se consacrant à l’examen in vivo des mutations de l’antisémitisme antique et moderne. Les développements contemporains lui furent occasion de prolonger le questionnement de l’archive judéophobe sous le rapport de ses mutations actuelles. Ce faisant, la grande histoire de l’antisémitisme se mua elle-aussi en histoire du temps présent. C’est à l’analyse du phénomène émergent de l’antisionisme qu’il consacra désormais le second versant de ses recherches, ouvrant encore de nouvelles perspectives.
L’analyse de l’antisionisme – en tant que troisième modalité historique de la judéophobie, après l’antisémitisme politico-culturel et l’antijudaïsme théologique, fait l’objet de deux essais capitaux, publiés à environ une décennie d’intervalle, l’un paru peu après la Guerre des Six jours (1967), le second dès après la première Guerre du Liban (1982).
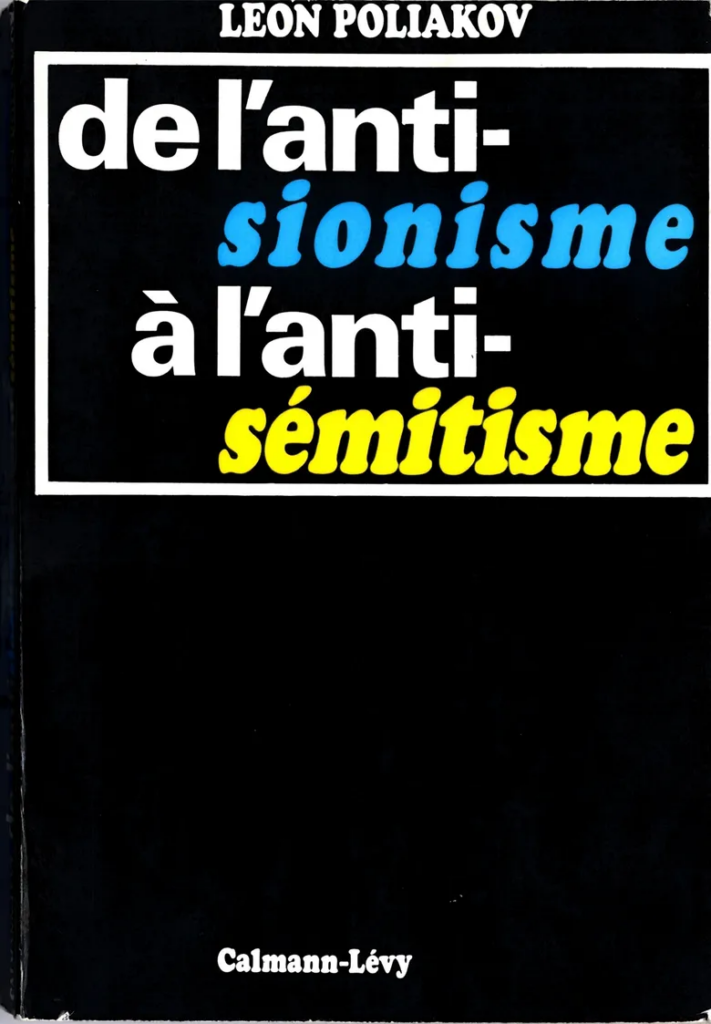
Le premier : De l’antisionisme à l’antisémitisme[6] vient battre en brèche le poncif aujourd’hui irrecevable selon lequel l’antisionisme n’est pas de l’antisémitisme. L’auteur y montre notamment le rôle joué par l’Union soviétique dans la formation de ce phénomène idéologique, en éclairant son arrière-plan, notamment lié au recyclage de l’antisémitisme russe dans le contexte du stalinisme, ainsi que le rôle de médiateur et de passeur joué par le nationalisme palestinien, dans la mesure où dès après 1948, dans le contexte du durcissement de la Guerre froide, l’URSS qui avait voté en faveur de la création de l’Etat d’Israël, chercha ensuite à fédérer dans son orbite l’ensemble du monde arabe, sous couvert de promotion du tiers-mondisme et des mouvements de décolonisation.
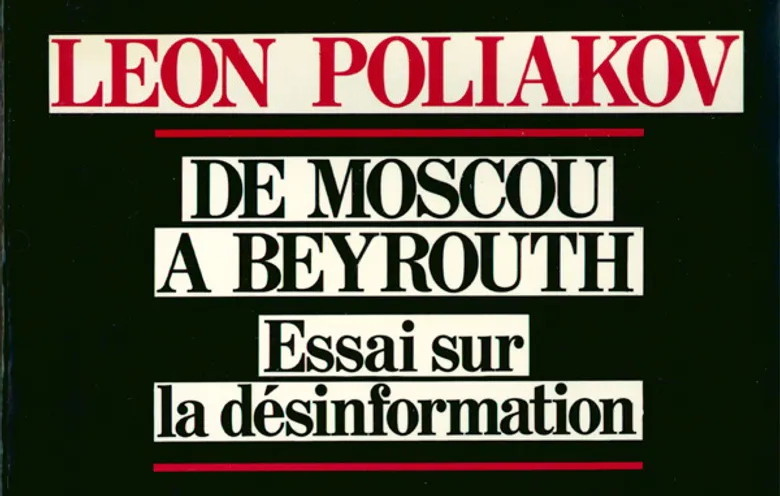
Le second : De Moscou à Beyrouth. Essai sur la désinformation[7], ouvre une piste nouvelle, qui s’avérera de première importance pour comprendre les évolutions contemporaines de l’antisionisme. L’auteur consacre un développement spécifique à ce qui marque à l’époque l’essor d’un antisionisme de type médiatique, prenant le relais de ses principales formations idéologiques (nazies, post-stalinienne et palestinienne), à destination de l’opinion publique. Ce moment marque aussi un point de mutation dans l’histoire du journalisme dont l’exercice fut de plus en plus investi par des militants, pratiquant, plus ou moins ouvertement l’art du parti pris objectif. Cette analyse permet également de dater le processus de nazification d’Israël, notamment manifeste dans les colonnes du journal Libération, organe de “l’idéologie 68”, qui fut le premier à comparer Beyrouth au Ghetto de Varsovie, et les terroristes du Fatah aux héros juifs de l’Hashomer Hatzaïr[8] emmenés par Mordechai Anielewicz (1919-1943), pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment du soulèvement de la population juive contre les divisions SS, chargées de la mise en œuvre de l’Aktion Reinhard (mars 1942-octobre 1943).
Cet infléchissement de l’antisémitisme moderne en antisémitisme de type national allait de pair avec la mise en circulation de nouveaux éléments de langage, qui se sont depuis lors amplement substitués à la connaissance historique, inhibant ainsi la volonté de savoir et l’esprit critique : l’imputation à Israël d’un projet de génocide, son assimilation constante à l’impérialisme, au colonialisme, au racisme, et corrélativement la mise en circulation d’un narratif palestinien de substitution d’avec l’histoire juive (Diaspora/expulsion, Nakbah/Shoah, Résistance, etc.). Les deux versants de ce faux narratif datent , l’un comme l’autre, de ce moment. Mais surtout, ces deux essais demeurent des pierres d’ancrage indispensables pour comprendre aujourd’hui la fonction vectrice jouée par la “cause palestinienne” et ses relais de la gauche radicale européenne, dans le développement d’un nouvel antisémitisme de type planétaire.
Le mérite de ce vaste édifice intellectuel, à tous égards accessible, tient à sa fonction de rappel de la mémoire historique récente mais aussi plus ancienne, dont les perspectives continuent d’éclairer les enjeux de notre époque. Naguère, nous avions eu le privilège de côtoyer l’homme et de l’inviter à dessiner pour les générations qui le suivraient les lignes de force de son questionnement[9]. Le regard que porte cette œuvre sur notre temps est un phare dans la nuit.
© Georges-Elia Sarfati*
*Georges-Elia Sarfati est philosophe, linguiste, psychanalyste, co-fondateur du Réseau d’étude des discours institutionnels et politiques, directeur de l’École française d’analyse et de thérapie existentielles (www.efrate.org), fondateur de l’Université Populaire de Jérusalem, lauréat du prix de poésie Louise Labbé.
© Georges-Elia Sarfati
Notes
[1] Initialement parue en cinq volumes (entre 1951 et 1977), aux Editions Calmann-Lévy, l’Histoire de l’antisémitisme a été reprise en édition de poche (d’abord aux Editions Hachette, Col. « Pluriel », 2 Vol. , 1981, puis aux Editions du Seuil, Col. « Points/Histoire », T.1. L’Age de la foi ; T.2. L’Age de la science, 1991).
[2] R. Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe, 1961, Ed. Fayard, 1988 ; Gallimard, Col. « Folio/Histoire », 2 Vol., 2006.
[3] Ed. Calmann-Lévy, 1951, réed. Presse Pocket, 1993.
[4] N. Cohn : Histoire d’un mythe. La conspiration juive et les Protocoles des Sages de Sion, Paris, Gallimard, 1967, réed. Col. « Folio/Histoire », 1992.
[5] Ed. Calmann-Lévy, 2 Vol. (180, 1985), réed. en 1 Vol., Calmann-Lévy, Col. « Mémorial de la Shoah », 2006.
[6] Cet essai a également paru aux Editions Calmann-Lévy, en 1969.
[7] Idem, en 1983.
[8] Littéralement : « La jeune garde », mouvement de jeunesse sioniste de gauche, fondé en 1913.
[9] Léon Poliakov, L’envers du destin. Entretiens avec Georges-Elia Sarfati, Paris, Bernard de Fallois, 1989.


Les suprémacistes blancs haïssaient les Juifs et considéraient les Noirs comme inférieurs.
Les suprémacistes islamistes haïssent les Juifs, les Chrétiens et toit ve qui n’est pas musulman.
Les suprémacistes”racisés”, afro-
americains, afro-eurpeens et africains
Haïssent les Blancs et les Juifs.
Les seconds et troisièmes sont alliés.
Il existe même parfois une sorte de convergence entre les derniers suprémacistes blancs et les nouveaux suprémacistes “racisés” (mille fois plus nombreux) : ainsi les cercles soraliens soutiennent Mélenchon et reprennent à leur compte le narratif pro Hamas qd cela les arrange.
L’idée principale : le racisme et l’extrême droite ont changé de couleur mais l’antisémitisme reste l’élément invariable, le point commun entre ancienne extrême droite (suprémacistes blancs) et nouvelles extrême droites (suprémacistes noirs et arabo-musulmans). En réalité c’est un processus fort simple à comprendre et à définir, mais qui pour être compris implique de debunker un demi siècle de mensonges et d’inversion des rôles (“antiracisme”).
Ce qui n’est malheureusement pas gagné.