
Une courte mémoire peut être utile comme mécanisme d’adaptation, mais elle est mortelle en matière de politique étrangère.
Dimanche marque le vingt et unième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. L’ampleur de l’assaut audacieux contre les symboles clés de la grandeur et de la puissance américaines – le World Trade Center à New York et le Pentagone à Arlington, en Virginie – était si extrême qu’il a été assimilé à une apocalypse.
Des images du renversement des tours jumelles, avec certains employés de bureau désespérés choisissant de mourir en sautant par les fenêtres, plutôt que de rester avec les milliers d’autres qui ont rencontré leur fin douloureuse à l’intérieur de l’enfer en ruine, ont été comparées à des scènes d’un blockbuster de Stephen Spielberg.
Les ondes de choc intérieures et extérieures ont été aggravées par le fait que les États-Unis avaient été isolés des combats sur leur sol (autre que pendant la guerre civile de 1861-1865) et du terrorisme islamiste. En l’espace d’environ deux heures ce matin fatidique, les Américains ont été secoués par le sentiment de sécurité parfaitement faux qui était à l’origine des premiers reportages sur un éventuel accident d’aviation.
Nous, Israéliens, en revanche, avons compris dès la première minute que ce n’était pas un accident. Bien que tout aussi horrifiés et surpris que tout le monde par l’ampleur et le lieu du meurtre de masse, nous n’avons pas été surpris par son apparition.
L’État juif était en proie à une guerre d’attentats-suicides, appelée la deuxième Intifada, lancée exactement un an plus tôt par l’Autorité palestinienne. C’était le résultat d’une capitulation répétée face aux exigences du chef archi-terroriste de l’OLP, Yasser Arafat. Plus Israël rampait, plus le lauréat du prix Nobel de la paix devenait autonome.
Comme je l’ai décrit à l’époque, pendant les 12 mois qui ont précédé le 11 septembre, nous avons passé nos journées à essayer de calculer quels bus pourraient exploser sur le chemin du travail ou sur le trajet de nos enfants vers l’école ; quel café, restaurant ou discothèque était trop risqué à fréquenter ; et quels sacs, sacs à dos sans surveillance ou regards obliques de certains personnages douteux étaient suspects.
Oui, des têtes roulaient littéralement dans des mers de sang juif dans les rues de Jérusalem, de Tel-Aviv et d’ailleurs, et continueraient à le faire pendant près de quatre ans et demi au total. Et ce n’était qu’un avant-goût de la tentative continue d’anéantir Israël depuis sa création en 1948. C’était aussi la preuve, s’il en était besoin pour ceux d’entre nous qui ont déploré les désastreux accords d’Oslo de 1993 et 1995, que la diplomatie avec les idéologues politiques islamistes non seulement ne fonctionnait pas, mais attisait leurs flammes.
Le sommet de Camp David qui a suivi entre le président américain de l’époque, Bill Clinton, le premier ministre israélien, Ehud Barak, et Arafat en juillet 2000, a été le précurseur immédiat, la cause et l’excuse de l’appel de ce dernier à une nouvelle série de massacres de Juifs. Il était donc normal pour les Palestiniens de célébrer le 11 septembre, ce que beaucoup d’entre eux ont fait en grande pompe.
Bien qu’une courte mémoire puisse être utile comme mécanisme d’adaptation, elle est mortelle en matière de politique étrangère. L’entrée de Barack Obama à la Maison Blanche en 2009 en est un parfait exemple.
Son premier ordre du jour était de renoncer à l’exceptionnalisme américain et de mener une « sensibilisation » au monde musulman radical. Les islamistes ont compris que cela signifiait que l’Oncle Sam, le « Grand Satan », avait été mis à genoux, grâce à leurs efforts. Ils n’avaient pas tout à fait tort.
La démarche d’Obama consistant à investir une énergie sérieuse en suppliant le plus grand État parrain du terrorisme de négocier un accord nucléaire n’a servi qu’à renforcer la détermination des ayatollahs à parvenir à l’hégémonie militaire et religieuse sur les « infidèles ».
Au moment où le régime dirigé par les mollahs a finalement « accepté » en 2015 de signer le Plan d’action global conjoint, il en avait modifié les termes à son avantage. La levée des sanctions et les milliards de dollars en espèces qu’elle a reçus étaient exactement ce dont elle avait besoin pour donner vie à ses centrifugeuses et remplir les coffres de ses mandataires terroristes dans tout le Moyen-Orient et au-delà.
Le successeur d’Obama, Donald Trump, a adopté l’approche inverse. Ce n’est pas seulement qu’il a fini par quitter le JCPOA en 2018 (après avoir été montré par le Premier ministre israélien de l’époque le trésor de documents que le Mossad avait récupérés dans un entrepôt à Téhéran, qui illustraient les violations iraniennes). Il a également lancé une campagne de «pression maximale» de sanctions accrues.
Couper la masse monétaire était nécessaire, à la fois pour ralentir le programme nucléaire et pour freiner les flux de trésorerie vers les terroristes. Juste au moment où cet effort commençait à avoir un effet, Joe Biden a pris les rênes du bureau ovale et a inversé le cours – en revenant à l’époque où il était le commandant en second d’Obama ; et avec bon nombre des mêmes collègues.
La réponse de l’Iran a été prévisible : augmenter ses conditions pour daigner être courtisé par le P5+1. Il a le luxe de le faire, en attendant un nouvel afflux de plusieurs milliards, en raison du contournement des sanctions par de nombreux pays et/ou sociétés en leur sein.
Pendant ce temps et en conséquence, le terrorisme financé par Téhéran contre les Israéliens s’est intensifié. Il en va de même pour l’équipe Biden concernant son engagement à empêcher l’Iran d’obtenir des armes nucléaires. Oh, et des déclarations tout aussi dénuées de sens concernant le droit d’Israël à se défendre.
Jusqu’à présent, la seule chose qui bloque le prochain JCPOA est l’intransigeance iranienne. Comme c’était le cas lorsqu’Obama « menait par derrière », Téhéran détient toutes les cartes. Selon les mots de feu Yogi Berra, “C’est comme du déjà-vu à nouveau.”
À l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre, rappelons-nous pourquoi ne pas trouver cela le moins du monde amusant.
(©) Ruthie Blum
Ruthie Blum est une journaliste basée en Israël et auteur de “To Hell in a Handbasket: Carter, Obama, and the ‘Arab Spring.’
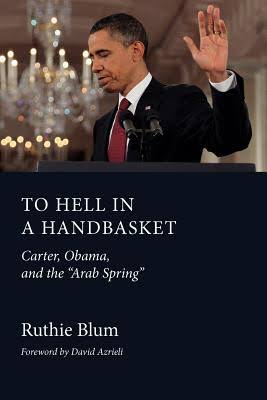
https://www.jns.org/opinion/the-unlearned-lessons-of-9-11/?utm_source=The+Daily



A lui seul, le terme et le concept d'”islamophobie” véhiculé par nos médias et showbiz parmi les plus détestables au monde constitue une victoire des islamistes et une insulte à leurs millions de victimes.
Le simple fait de parler d’une islamophobie imaginaire comme s’il s’agissait d’une réalité et inversement de ne pas pouvoir nommer des choses hélas on ne peut plus réelles prouve qu’ils ont déjà gagné…avec la complicité de toute “l’élite” (mot qui désigne par antithèse la partie globalement la plus bête et méchante de la société). Et cette inversion des rôles explique en grande partie pourquoi ceux-là mêmes qui diabolisent la Russie font souvent ami-ami avec l’Iran, la Turquie, l’Algérie…
J’ai envoyé des courriers recommandés à plusieurs dirigeants L.F.I pour leur dire qu’ils ont une grande part de responsabilité dans la détestation d’Israël. Ils n’ont jamais répondu. Et bien sûr je leur faisais comprendre, qu’ils n’étaient pas simplement antisioniste.
@Di Pietrantonio
Autant écrire aux Talibans pour leur dire qu’ils ont une grande part de responsabilité dans la dégradation de la condition féminine en Afghanistan…