A l’aube du XXIe siècle, la production littéraire israélienne se caractérise par une grande diversité de thèmes et de sensibilités. Les nouvelles générations, qui ont remplacé les anciens devenus des « classiques », sont en train de renouveler le champ littéraire, tout en restant fidèles à la mission de préservation de la mémoire singulière de leur communauté. Etat des lieux à l’occasion des 70 ans de la création d’Israël.
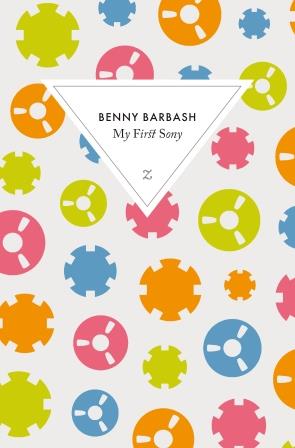
Ce sont peut-être les écrivains israéliens qui incarnent le mieux l’image d’une société créative et avant-gardiste que les dirigeants de leur pays veulent mettre en avant en cette année du 70e anniversaire de l’Etat hébreu. Forte d’un corpus riche et pluriel en termes de sensibilités et de genres, résolument moderniste tout en se campant dans un équilibre précaire entre le passé, le présent et l’avenir, la littérature d’Israël est représentative du questionnement intellectuel d’un peuple qui revient de loin. Le nouvel opus du jeune romancier Yishaï Sarid, paru récemment en traduction française sous le titre Le Troisième temple (Actes Sud), est emblématique de cette vitalité littéraire.
Situé au carrefour du polar, du fantastique et de l’anticipation, ce roman habilement construit sous la forme d’un journal retrouvé, imagine la reconstruction du troisième temple à Jérusalem, à l’emplacement même des deux premiers, tout comme le prophétise la croyance traditionnelle juive. Or, ce qui n’était pas prévu par la tradition, c’est la destruction de l’Etat juif et la quasi-annihilation de son peuple qu’entraîne dans les pages du récit la réalisation de la prophétie antique. Tel-Aviv et Haïfa ont été rayés de la carte, « vaporisés » par les Amalécites, l’ennemi héréditaire. Tout n’est que sang, guerre et dévastation.
Le retour aux sources bibliques, appelé à cor et à cri par la droite israélienne qui domine le champ politique, devient sous la plume du romancier une allégorie de l’enfermement et des menaces que fait peser sur la civilisation le repli religieux à l’œuvre dans la société israélienne contemporaine. Le récit de Yishaï Sarid se lit comme l’avertissement inquiet lancé par un observateur israélien face aux dérives que connaît son pays.
Cette créativité imaginative puissante, doublée de l’engagement politique et social, est devenue la marque de fabrique de la littérature israélienne moderne, qui compte dans ses rangs quelques-unes des grandes voix telles que Yehudah Amichai, Amos Oz, A. B. Yehoshua, David Grossman, Aharon Appelfeld, Savyon Liebrecht, Orly Castel-Blum, pour ne citer que ceux-là. Ils sont traduits en nombreuses langues et connus dans le monde entier.
Une histoire originale
La littérature israélienne a une histoire originale qui se confond en partie avec le renouvellement de l’hébreu comme langue vivante. Certes, compte tenu de la diversité des origines de la population juive, fondatrice d’une réalité pluriculturelle et plurilinguistique, il serait réducteur de limiter la création littéraire israélienne à sa seule expression « hébraïque ». Il n’en reste pas moins que l’hébreu est la langue la plus parlée en Israël et sa littérature est principalement écrite en hébreu, servant de support à la construction nationale.
Le militantisme littéraire israélien a des racines profondes dans la littérature hébraïque et débute en réalité avec l’avènement de la modernité à la fin du XVIIIe siècle. C’est dans les ghettos de l’Europe centrale et orientale qu’est née la littérature hébraïque moderne, sous l’influence des philosophes des Lumières. Poètes et prosateurs appellent alors à la révolte contre les structures mentales et traditionnelles, libérant la pensée juive de ses cadres religieux.
Ce mouvement est connu sous le nom de Haskalah (qui signifie en hébreu « agir avec discernement »). Il est incarné par des philosophes, des réformateurs sociaux, des poètes et des chroniqueurs. Le nouvel imaginaire juif qui fait une large place aux idéaux de fraternité et à la raison s’exprime dans les langues locales (allemand, polonais, russe, yiddish), mais aussi en hébreu, langue archaïque que les écrivains tentent d’arracher à son joug rabbinique.
En 1858, paraît le premier roman hébreu Ahavat Sion ou « L’Amour de Sion » sous la plume d’un certain Abraham Mapou, alors que d’autres s’intéressent à la grammaire hébraïque. C’est le signal de la renaissance de l’hébreu qui deviendra bientôt, sous l’égide du linguiste et nationaliste juif éminent Eliezer Ben Yehouda, le support privilégié du sionisme montant, avant de s’imposer comme la langue officielle de l’Etat d’Israël en 1948.
Les pionniers
Le deuxième acte de la renaissance culturelle hébraïque se joue sur la terre même du futur Israël où, entre 1880 et 1920, plusieurs milliers de juifs d’Europe centrale viennent s’installer avec l’espoir d’y renouer avec leur histoire. Parmi eux, des poètes et romanciers talentueux qui avaient commencé leur carrière en Europe de l’Est et vont poursuivre leurs oeuvres en Palestine. Haïm Nahman Bialik, Saül Tchernikhovsky et S.Y. Agnon (Prix Nobel de littérature en 1966) sont les écrivains emblématiques de cette période de transition. Ils sont considérés comme les pères de la littérature hébraïque moderne et leurs écrits retracent avec lucidité et émotion l’aventure séculaire du peuple juif, placée sous le double signe de l’errance et de la perte.
Plus combatifs sont les écrivains de la génération de la guerre d’indépendance, désignés aussi par le nom de « génération du Palmach » à cause de leur enrôlement dans les Palmachs ou les unités de choc de l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Nés pour la plupart dans des kibboutzs, en Palestine, ils puisent la matière de leurs écrits dans leurs expériences de pionniers et dans leurs combats contre la nature aride pour construire la nation à venir. Ce sont des œuvres éminemment nationalistes et idéologiques, obsédées par le devenir collectif.
Génération « 48 »
L’Etat d’Israël est créé le 14 mai 1948. Il faudra attendre encore une dizaine d’années pour que la littérature reprenne ses droits, prenant ses distances par rapport aux célébrations national-sionistes. En effet, c’est dans les décombres des mythologies identitaires et des utopies qui ne résistent pas à la corruption de la pratique politique au quotidien, que vient à maturité une nouvelle génération d’écrivains israéliens dont les principaux épigones ont pour noms Amos Oz, Avraham B. Yehoshua et Aharon Appelfeld. Avec ces écrivains imprégnés de Kafka et de l’existentialisme qui vont à leur tour marquer d’une manière indélébile les lettres israéliennes, on passe de la célébration à l’interrogation, de la collectivité à l’individu, du héros à l’anti-héros.
A travers des formes complexes et souvent allégoriques, leurs récits explorent inlassablement des destins individuels pris dans les rets de la mémoire et de l’histoire. Leurs thématiques vont de la critique sociale à la quête individuelle, en passant par l’incommunicabilité, le désespoir et, bien sûr, la tragédie absolue de l’Holocauste. C’est Aharon Appelfeld qui a bâti l’essentiel de son oeuvre sur le thème de la Shoah. Rescapé lui-même d’un camp de concentration en Roumanie où il fut déporté dans sa jeunesse, l’auteur de La Chambre de Mariana interpelle sans cesse les ténèbres du génocide juif dans une tentative quasi-désespérée de se libérer des fantômes de son propre passé. Dans son sillage, d’autres romanciers (notamment David Grossman) et poètes se sont saisis de ce sujet et tentent de restituer la barbarie et l’horreur à travers le regard des jeunes générations.
Se libérer du politique
Or, le regard que portent ces jeunes générations d’Israéliens sur les tragédies de leur histoire est étonnamment dénué d’enthousiasme. Celles-ci réclament des récits sur l’ici et maintenant, mieux enracinés dans leur société urbanisée, féminisée, atomisée, multiculturelle. Elles feront éclater le monde littéraire hébraïque trop longtemps prisonnier d’un imaginaire dominant monolithique, patriarcal, ashkénaze et laïque, où il y avait peu de place pour la pluralité. Aussi, assiste-t-on à partir des années 1980 à une véritable révolution littéraire avec l’entrée en scène des femmes, des minorités sépharades, des Arabes israéliens, des immigrants d’Irak, du Yémen et de Syrie. Ils ont pour noms Amir Gutfreund, Orly Castel-Bloom, Sayed Kashua, Etgar Keret, Alona Kimhi, Alon Hilu, Judith Katzir, Ron Leshem, Anton Shammas, pour ne citer que les plus connus. Et je rajouterai parmi mes préférés Benny Barbash dont il faut tout lire, mais surtout, “My first Sony” et Zruya Shalev.
En l’espace de deux décennies, ces nouveaux venus ont changé profondément la littérature israélienne : ils ont diversifié les genres et renouvelé les thèmes en s’investissant dans l’existentiel et dans le quotidien. Ils ont surtout pris soin de se démarquer de leurs prédécesseurs en affichant leur vocation à ne pas être des intellectuels vis-à-vis du champ politique. « La littérature est une chose plus profonde que la politique », affirme la romancière Zeruya Shalev, proclamant l’entrée de la littérature hébraïque dans l’ère post-sioniste.
Sans pour autant abandonner définitivement l’engagement et la préservation de la mémoire, comme en témoigne Le Troisième temple par lequel nous avons ouvert ce panorama. Le questionnement de la tradition auquel s’y livre son romancier talentueux est aussi une forme de préservation de la mémoire. Yishaï Sarid de reprendre à son compte les propos du regretté Aharon Appelfeld définissant la mission du romancier israélien à travers l’idée qu’il se faisait de son propre travail: « Je n’écris pas un livre. J’écris une saga du peuple juif. J’écris sur cent ans de solitude juive ».
En bonus, un poème de Yehuda Amichai dont j’ai fait la connaissance par l’intermédiaire de la romancière Batya Gour. Auteure de romans policiers, elle a un jour laissé de côté le commissaire Michael Ohayon, pour écrire un petit livre merveilleux, “Là où nous avons raison”, qui raconte l’histoire de la mère d’un soldat dont le fils est tué lors d’un bizutage stupide et tragique, pendant son service militaire.
Et voici le texte qui précédait le roman :
Là où nous avons raison,
Jamais ne pousseront
De fleurs au printemps.
Là où nous avons raison
Le sol est piétiné et dur
Comme une cour.
Mais les doutes et les amours
Labourent le monde
Comme une taupe, comme une charrue.
Et un murmure se fera entendre à l’endroit
Où se trouvait la maison
Qui a été détruite.


Poster un Commentaire