Par Charles Rojzman
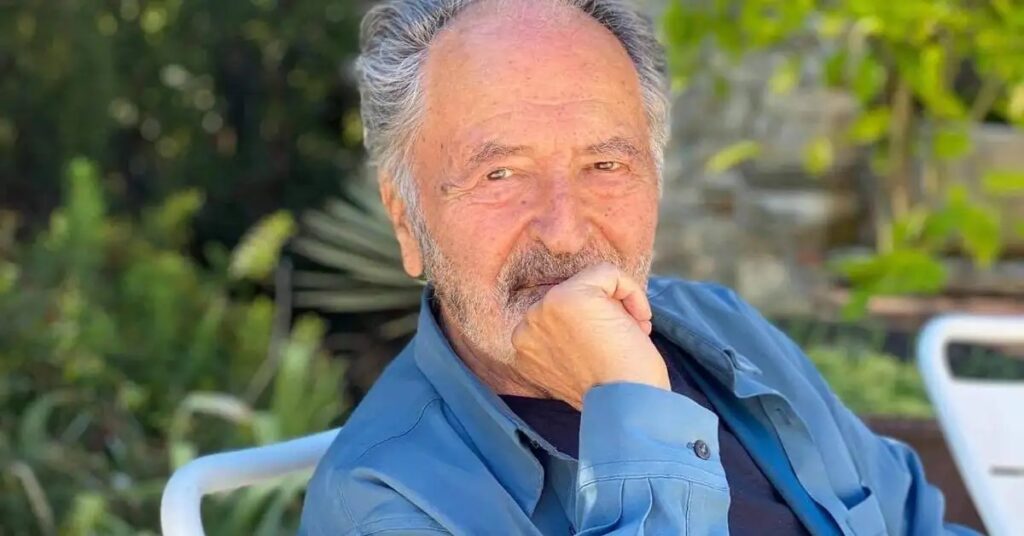
En début de soirée, en pleine célébration de Kippour, une synagogue du quartier de Prestwich a été prise pour cible. Un homme a d’abord foncé sur les fidèles au volant d’une voiture, projetant plusieurs d’entre eux au sol, avant de sortir armé d’un couteau de boucher. La scène fut d’une brutalité aveugle : plusieurs personnes ont été fauchées, dont deux mortellement, puis frappées dans la panique générale.
Selon des témoins, il aurait crié « Allahu Akbar » et invoqué Gaza ou Israël pour justifier son geste. Des sources policières évoquent l’examen de messages publiés sur les réseaux sociaux, où il aurait tenu des propos haineux contre les Juifs et leurs « protecteurs ». L’enquête antiterroriste en cours doit confirmer ou non ces éléments, mais l’intention antisémite et djihadiste ne fait guère de doute aux yeux des enquêteurs…
Cet acte n’est pas une folie isolée : il s’inscrit dans une logique globale. Depuis des années, l’Europe vit au rythme d’un djihad qui vise explicitement les Juifs et, à travers eux, l’Occident tout entier. Chaque attaque contre une école juive, un supermarché casher, une synagogue, n’est pas seulement une vengeance symbolique contre Israël : c’est une guerre déclarée à ce que les islamistes nomment « l’Occident corrompu », accusé d’être infidèle, matérialiste, impie. Gaza et la cause palestinienne ne sont ici que des prétextes, des drapeaux moralisés qui habillent une haine beaucoup plus vaste.
Les exemples abondent. Toulouse, mars 2012 : Mohamed Merah abat trois enfants et un enseignant parce qu’ils étaient juifs, et déclare agir pour « venger les enfants de Gaza ». Bruxelles, mai 2014 : Mehdi Nemmouche tue quatre personnes au Musée juif, se revendiquant de l’État islamique et de la « cause palestinienne ». Paris, janvier 2015 : Amedy Coulibaly exécute quatre Juifs à l’Hyper Cacher, expliquant qu’ils étaient « coupables » des crimes d’Israël.
Mais les Juifs ne sont pas les seules cibles. Les massacres de masse le montrent : le Bataclan, en novembre 2015, où des islamistes exécutent des dizaines de jeunes réunis pour la musique ; Nice, en juillet 2016, où un camion lancé sur la foule fait 86 morts le soir de la fête nationale ; Londres, Madrid, Bruxelles, Berlin… Chaque fois, ce sont les symboles de la vie occidentale — un concert, un marché, une promenade, un métro — qui sont frappés. Pour les terroristes, il s’agit d’un seul et même combat : punir les Juifs d’exister, et punir les Occidentaux d’incarner un monde impie, libéral, égalitaire, qu’ils veulent abattre.
Ce djihad est nourri par une propagande qui sait parfaitement utiliser l’imagerie palestinienne comme carburant émotionnel. Dans les mosquées radicales, sur les chaînes satellitaires, sur les réseaux sociaux, les photos d’enfants blessés à Gaza sont brandies comme preuves d’injustice et appels à la vengeance. Peu importe qu’elles soient souvent manipulées ou mises en scène : elles servent à forger une mythologie sacrificielle. Ainsi, tuer un Juif en Europe, c’est, dans cette logique, venger la Palestine et défier l’Occident complice.
Mais ce qui pourrait sembler propre au monde musulman résonne étrangement dans nos sociétés occidentales déchristianisées. Car si la référence religieuse a disparu, le vieux réflexe demeure : il faut un coupable, il faut une figure qui concentre la culpabilité du monde. Le djihadiste et l’universitaire progressiste, le prêcheur radical et l’ONG humanitaire parlent un langage différent, mais jouent la même partition : celle d’une culpabilisation totale qui exige un bouc émissaire. L’un crie « Allahu Akbar » en brandissant Gaza ; l’autre manifeste « pour la Palestine » au nom des droits de l’homme. Dans les deux cas, le Juif — ou son avatar collectif, Israël — est sommé d’incarner le mal absolu.
C’est là un véritable jeu de miroirs : l’islamisme radical apporte la violence nue — l’assassinat, l’attentat — ; l’Occident post-chrétien lui apporte la justification morale — les mots d’universel, la tribune, la pétition, la posture humanitaire. L’un frappe les corps, l’autre frappe les consciences. L’un tue des enfants dans la cour d’une école, l’autre publie des manifestes expliquant qu’Israël est un État d’apartheid. Ensemble, ces dynamiques recomposent la vieille accusation sous une forme nouvelle : ce que l’un commet, l’autre l’excuse ; ce que l’un proclame, l’autre l’habille d’un langage noble. Leur convergence rend la haine contre Israël d’autant plus dangereuse qu’elle unit la barbarie à la bonne conscience.
Le Juif, éternel coupable
« Les Juifs sont responsables de l’antisémitisme. » Cette phrase, proférée jadis par un collaborateur sans envergure comme Louis Thomas, n’est pas un accident du XXe siècle : elle est l’axe de l’histoire européenne, son refrain le plus constant, son blasphème quotidien, répété de siècle en siècle, de bûcher en pogrom, d’expulsion en extermination. Elle traverse les empires et les religions, elle change de masque et de lexique, mais elle demeure. Toujours, la même inversion : l’antisémite ne se pense pas bourreau mais justicier, soldat du Bien, médecin d’un monde corrompu dont le Juif est la gangrène.
Depuis deux millénaires, la civilisation chrétienne a porté en elle cette certitude : le Juif est le peuple déicide, marqué d’un sceau indélébile. Dans l’islam, il a aussi souvent reçu la figure du peuple maudit, voué à l’humiliation. Dans la modernité sécularisée, il devient l’éternel corrupteur — banquier insatiable, révolutionnaire subversif, cosmopolite dissolvant. À chaque âge son vocabulaire ; à chaque âge la même fonction : incarner le Mal et servir de miroir à ce que la société refuse de voir en elle-même.
Toléré, expulsé, parqué, exterminé : l’histoire juive est une traversée où la tolérance ambiguë cède souvent le pas à la haine déclarée. Même quand il se fait patriote, le Juif reste suspect ; même lorsqu’il s’assimile, il demeure étranger. Sa réussite est preuve de domination, sa misère preuve de perfidie. S’il observe ses rites, il est archaïque ; s’il les abandonne, il est perfide. À chaque posture, une accusation. C’est l’impossible innocence.
On a cru qu’Auschwitz avait brisé ce cercle, qu’après la Shoah l’Europe ne pourrait plus prononcer l’indicible. Mais le vieux discours n’a pas disparu : il s’est déplacé. L’objet a changé, la mécanique demeure. Le Juif d’aujourd’hui porte parfois le nom d’Israël. Ce qui fut autrefois un individu fragile est devenu un État souverain ; mais la fonction symbolique est identique : Israël incarne, pour beaucoup, la culpabilité universelle.
Le vocabulaire a évolué : aux imprécations théologiques ou raciales ont succédé les mots du droit, de la morale humanitaire, de la pureté démocratique. Israël est accusé d’être colonial, raciste, génocidaire ; ses contempteurs se proclament défenseurs de l’universel. Ils répètent, sans le savoir souvent, la vieille inversion : la victime est coupable de sa persécution ; sa défense est crime ; son existence même devient scandale. Israël ne peut être innocent, pas plus que le Juif ne l’a jamais été aux yeux des accusateurs. Même son droit à la survie est présenté par certains comme une offense, car il déjoue le récit souhaité d’une disparition réparatrice.
Le conflit israélo-palestinien, transformé en liturgie planétaire, est devenu le théâtre où se rejoue l’antique drame. Le Palestinien — figure bricolée, réinventée comme martyre absolu — sert à laver les fautes coloniales réelles ou supposées de l’Occident. Israël joue alors le rôle du bourreau métaphysique. L’antisionisme radical n’est plus toujours une critique politique argumentée : il tend à se convertir en religion séculière, en rituel de purification qui exige le sacrifice d’un bouc émissaire collectif.
Ainsi, la haine s’est parée d’oripeaux vertueux. Elle s’exprime dans les arènes internationales, les médias, les campus universitaires. Elle ne dit plus nécessairement « À mort le Juif » ; elle dit « Justice pour la Palestine ». Mais c’est la même opération : retourner la réalité et attribuer à la victime la culpabilité. Car ce qui dérange, finalement, ce n’est pas seulement la douleur historique : c’est la résurrection. Un peuple qui reste debout, qui garde sa mémoire et sa force, est une offense pour ceux qui auraient voulu sa disparition.
Il n’existe pas de réponse purement rationnelle à cette obsession : elle relève d’un besoin anthropologique. Chaque société, en période de crise, cherche son signe d’infamie, sa figure explicative du mal. Hier le Juif, aujourd’hui Israël : la mécanique est la même, le masque a changé.
Rien n’a véritablement disparu : la haine s’est sophistiquée, elle a troqué les croix gammées pour les banderoles d’ONG, les sermons pour les slogans militants. Mais la musique reste la même ; la partition a été seulement réarrangée.
Israël est devenu ce que fut le Juif dans les ghettos : un signe d’infamie nécessaire, une cible inépuisable. Et c’est pourquoi, pour tant de consciences, la disparition d’Israël — réelle ou symbolique — se transforme en promesse de rédemption. Car l’existence juive, qu’elle soit individuelle ou nationale, rappelle que la mémoire a résisté, que le peuple n’a pas été englouti, qu’il demeure debout dans un monde qui, par instants, voudrait qu’il se taise à jamais.
Conclusion : deux fronts d’un même combat
Les attaques contre les Juifs et les attentats visant les foules occidentales ne sont pas des phénomènes parallèles sans lien : ils appartiennent à une même logique de guerre idéologique. D’un côté, la violence ciblée contre les communautés juives vise à frapper directement l’ennemi symbolique, perçu comme la racine de la corruption du monde ; de l’autre, les massacres de masse contre des concerts, des fêtes nationales, des cafés ou des marchés de Noël visent à abattre la civilisation occidentale elle-même, héritière de la chrétienté, porteuse d’une liberté, d’une égalité entre hommes et femmes, d’un pluralisme que le djihad juge insupportables.
Gaza et la Palestine ne sont que le prétexte qui relie ces deux fronts. Dans l’imaginaire islamiste, le Juif représente l’ennemi éternel à éliminer ; l’Occident est l’espace à conquérir ou à réduire en ruines pour effacer ce qu’il symbolise : l’autonomie des individus, la sécularisation, la démocratie, la liberté de conscience. Juif et Occident apparaissent ainsi comme deux figures d’une même altérité à détruire, l’une comme corps visible de la haine, l’autre comme civilisation à soumettre.
Ce double assaut rend notre époque particulièrement dangereuse : il ne s’agit plus seulement d’exterminer un peuple, mais de délégitimer et de détruire un monde. L’un frappe les corps, l’autre vise les fondements culturels et politiques. Ensemble, ils menacent la mémoire, la liberté, et la possibilité même de vivre dans des sociétés ouvertes.
Reconnaître cette réalité, la nommer avec précision, cesser de dissocier les formes contemporaines de la haine de leurs racines historiques — c’est la première condition pour y répondre. Sans cette lucidité, nous resterons condamnés à voir renaître, à intervalles réguliers, le même mécanisme de bouc émissaire et la même violence, sous des masques différents.
Car si l’histoire nous enseigne une chose, c’est bien celle-ci : appeler le Juif et Israël « coupables » ne sauve aucune société de ses contradictions. Cela ne purifie pas, cela ne guérit pas : cela corrompt. Et le prix à payer pour ce renoncement est toujours réglé en sang et en mémoire.
© Charles Rojzman
En vente chez FYP Éditions :
En ligne, aux adresses suivantes :
Avant-dernier ouvrage paru :
« Les Masques tombent. Illusions collectives, Vérités interdites. Le réel, arme secrète de la démocratie ». FYP Éditions
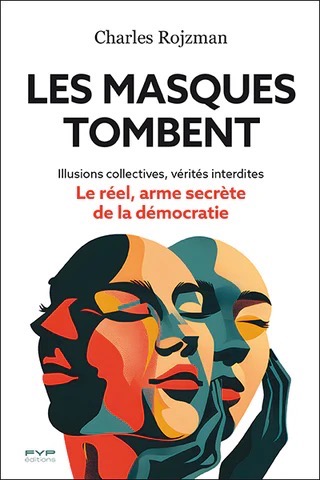
***
Dernier ouvrage paru :
La Société malade. Échec du vivre ensemble, chaos identitaire : comment éviter la guerre civile
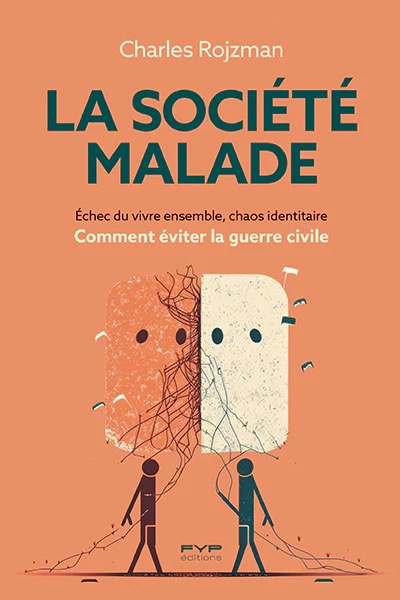


Poster un Commentaire