Moses Hess est le père de la social-démocratie allemande. Il est, avec Rome et Jérusalem en 1862, le précurseur du sionisme moderne, trente-quatre ans avant L’Etat des Juifs de Theodor Herzl, vingt ans avant Autoémancipation de Léo Pinsker.
Je l’ai lu il y a quelques mois et retranscris ici mon sentiment à sa lecture, mais avant cela, quelques mots liminaires sur ce que je m’attendais à y trouver.
On retrouve souvent chez les fondateurs – ashkénazes – du sionisme un rejet de la condition galuthique, et par extension, un rejet de la religion, qui se manifeste parfois chez leurs continuateurs par un mépris vis-à-vis des Juifs traditionalistes, modalité du judaïsme sous laquelle vivaient et vivent l’essentiel du monde séfarade. « De fait, tandis qu’en Europe orientale le sionisme est né en partie d’une rupture avec les structures communautaires – le monde ashkénaze des ghettos et des yeshivot –, il fut au contraire synonyme, en Afrique du Nord, d’une forme de réappropriation et de revalorisation du passé juif. » écrit Iris Lévy dans un article fouillé sur le KKL en Afrique du Nord dan la première moitié du XXè iècle.
Chez Hess, on ne retrouve pas ce mépris pour la tradition religieuse, il peut être lu sans malaise par un Juif traditionaliste. Je ne l’ai personnellement pas lu avec cet a priori, d’une part parce que je ne suis guère plus traditionaliste, d’autre part et surtout parce que j’ignorais que Hess manifestât ce respect vis-à-vis de l’orthopraxie.
Avant de le lire, je savais peu de choses de Hess, quelques repères biographiques, et je projetais la pensée des autres fondateurs du sionisme sur la sienne – leurs biographies étaient en tout point parallèles – en lui attribuant une certaine prescience.
Je connaissais ainsi son parcours, camarade de Marx et Engels, assimilé de fait, père de la social-démocratie allemande selon son épitaphe, adhérant ainsi à la religion de l’humanité, et comme de nombreux penseurs sionistes modernes dans un mariage mixte (je pense en particulier à Max Nordau).
Je vois trois raisons d’être sioniste, sans ordre particulier :
Un motif religieux : la tradition religieuse renouvelle à chaque seder de Pessah le vœu de retour à Jérusalem, et dans la prière quotidienne l’attachement à la terre d’Israël, l’espérance du kibbutz galuyot, du rassemblement des exilés. Espérance longtemps repoussée aux temps messianiques, et qui, sans l’activisme des sionistes laïques, n’aurait sans doute pas été souhaitée ici et maintenant.
Un motif politique : l’Emancipation ne résout pas l’antisémitisme, elle l’exacerbe même parfois. Elle permet d’inclure les Juifs par des droits civiques, mais n’est pas toujours suffisante pour lever l’exclusion de la société. Et l’antisémitisme n’intéresse que les Juifs. Il faut une auto-émancipation pour le combattre – puisqu’il nous concerne en premier lieu – et pour nous redonner un peu de fierté politique.
Un motif existentiel : l’Emancipation rend supportable l’existence juive mais la dissout en même temps. Elle déjudaïse de fait, produit des derniers des Juifs. Le sionisme permet et la sécularisation et la transmission de la judéité, en d’autres termes permet d’être un Juif laïque sans être un dernier des Juifs.
Chez presque tous les penseurs sionistes, la proposition sioniste est précédée d’un exposé de la question juive, sous la forme des deuxième et troisième motifs, avec, comme je l’ai dit plus haut, un certain dédain pour la pratique religieuse, rétrograde, et surtout inopérante : l’an prochain à Jérusalem a déjà été différé deux millénaires par la tradition religieuse, s’il doit y avoir un renouveau de la judéité, il est à trouver en dehors d’elle.
Je m’attendais à retrouver ces deux motifs dans Rome et Jérusalem. Les premier et troisième motifs sont mutuellement exclusifs. Si l’on croit fermement en la religion et en la mystique juives, notre existence en tant que juifs n’est pas menacée par l’Émancipation, la religion nous en protège déjà.
Inversement, si nous sommes déjudaïsés, il n’y a pas lieu de s’accrocher à un retour à Sion messianique.
Il faut tout de même qu’il y ait quelques réminiscences, sinon le projet sioniste n’aurait pas désiré spécifiquement la terre d’Israël. (Incidemment, le grand-père de Herzl était un élève de Judah Alkalai, l’un des rabbins sionistes avant la lettre, avec Zvi Hirsch Kalischer ou Yehuda Bibas, et il est probable que Theodor Herzl ait été influencé par le protosionisme d’Alkalaï).
C’est donc avec un certain embarras, presque une pointe de déception que j’ai lu Rome et Jérusalem. Je m’attendais à y trouver des intuitions prescientes sur l’impossibilité de la condition juive en diaspora après l’Émancipation et la sécularisation de l’Europe, et donc la nécessité d’une autodétermination nationale, le sionisme.
Pour tout dire, je m’attendais à y trouver une confirmation de ma propre déjudaïsation. Cette attente avait grossi plus encore après avoir lu la préface où l’identification avec le profil sociologique de Hess, déjudaïsé, épousant une non-juive, socialiste, embrassant la religion de l’humanité m’était particulièrement saisissante.
Or, en le lisant, j’étais assez indifférent aux motivations de son sionisme. L’incapacité de l’humanisme socialiste – ou plutôt l’insensibilité – à la question juive, à la question de la préservation de la judéité, dit Hess à raison, plaide pour l’autonomie. Mais Hess ne me convainc guère quand il reste fasciné par l’orthopraxie juive – pratique religieuse de laquelle il s’est progressivement détaché sans possibilité de retour, comme de nombreux « Juifs modernes ». Dans ce retour au religieux, on se demande s’il y avait réellement besoin d’une autonomie territoriale pour préserver l’identité juive, quand on est convaincu, comme semble l’être Hess, des vertus de la pratique religieuse et du foyer familial juif.
J’écris ce doute un siècle et demi après Hess, et surtout un siècle après que l’idée de Hess ait été suivie, approfondie, puis réalisée, que l’État d’Israël a été établi, et maintenant que son existence semble assurée.
Israël a été fondé par des Juifs laïcs, comme l’était Hess, pour répondre à deux problèmes : s’émanciper de la condition qui nous est faite, des oppressions antisémites d’une part, et d’autre part répondre à un déchirement identitaire insoluble parmi les nations : détachement de la pratique religieuse – concomitante à la sécularisation et la rationalisation des sociétés d’accueil, pourquoi devrions-nous exclure de ce phénomène ? – et risque de dissolution de l’identité juive que l’on souhaite freiner. (Zangwill écrit dans La voix de Jérusalem, que jusqu’ici la collectivité juive a persisté « par ses persécuteurs et par ses fous », par l’antisémitisme et par les gardiens zélés de la tradition, qu’il faut renationaliser la judéité pour se défaire de ces deux oppressions, extérieure et intérieure.)
Israël rend la sécularisation possible, autonome, elle n’oblige pas à demeurer religieux pour préserver l’identité juive collective et individuel.
Hess écrit que « le Juif pieux est un juif patriote » (p. 85). Quel besoin alors de terre si la patrie portative n’est pas en péril existentiel ? « Il faudrait renoncer à l’émancipation pour préserver la nationalité juive » ajoute-t-il quelques phrases plus loin, intuition qui justifie autant l’auto-émancipation qui préserve et l’émancipation individuelle et la nationalité que la communauté orthodoxe diasporique. Cette dernière souffre de l’antisémitisme mais pas d’un péril existentiel auto-infligé. Seul le Juif solitaire et déjudaïsé risque de faire disparaître sa judéité, et du fait de sa responsabilité collective, celle de tous les Juifs.
Si ce déchirement intérieur n’existait pas, le sionisme reste possible et souhaitable, la solitude contre l’antisémitisme, le besoin d’autonomie contre un mal qui ne frappe que les Juifs, les renaissances nationales au XIXème siècle qui obligent le Juif, religieux ou non, à choisir univoquement sa nation d’accueil, le mouvement général des renaissances nationales que le Juif peut lui aussi vouloir imiter, etc. tout cela concourt à une renaissance nationale juive, et il n’est pas besoin d’être déjudaïsé, laïc ou presque assimilé pour la désirer.
Mais chez Hess, encore une fois, quelque chose m’embarrasse.
Deux reniements m’embarrassent.
Le premier à l’égard de son propre mariage mixte, quand il loue la vertu de la famille juive et de la femme juive. Le second à l’égard de ses propres interrogations religieuses. (L’hébreu a une jolie formule pour désigner la perte du sentiment religieux, ‘hozer bechéela). Il est ému devant la solennité et la vigueur de la prière collective – à raison sans doute – mais il cède à cette émotion, sent bien que ses introspections religieuses, son détachement de la tradition, son dédain du rite ne sont pas transmissibles, alors il loue une tradition à laquelle il est désormais étranger, une foi qu’il n’a pas, en quelque sorte par procuration, par la procuration du foyer de sa belle-sœur.
Hess n’est pas orthodoxe, a des mots très durs contre l’orthodoxie, religion « figée », « carapace » (p. 100), des mots proches de ceux que Memmi utilisera un siècle plus tard quand il parlera d’enkystement dans La libération du Juif. Mais ses mots les plus durs vont contre le mouvement réformé. Hess note avec raison que le mouvement réformé conduisait à une dénationalisation profonde de la religion juive, à une dé-ritualisation et à une spiritualisation. Autant de ferments d’une disparition du judaïsme en tant que tel.
Mais Hess semble privilégier l’orthodoxie pour revitaliser le judaïsme. Sans trop savoir comment le formuler, il me semble que dans un Israël assuré, sans plus faire porter le poids de la transmission de l’identité juive sur la religion, le judaïsme se libérerait, s’épanouirait, quitterait sa carapace protectrice, et deviendrait précisément un judaïsme réformé. « Devrions-nous, écrivez-vous avec esprit, reprocher à nos maîtres juifs cultivés d’avoir apporté la lumière des sciences à la place de l’écorce rigide du rabbinisme qu’ils ont “brisée de l’extérieur” » (p. 118) rapporte-t-il de sa correspondante à qui sont dédiées les onze lettres qui composent Rome et Jérusalem.
Je ne suis guère convaincu par les réponses qu’apporte Hess à cette question, pour une raison très prosaïque : je n’imagine pas Hess orthodoxe. Dans une synagogue orthodoxe, il serait un spectateur fasciné, pas un fidèle. « S’il n’était qu’un dogme religieux, le judaïsme aurait dû éclater comme le christianisme à la suite des Lumières ; mais il est une religion nationale » (p. 120)
Certes, il est la religion d’une nation. Mais parce que cette nation est sans terre, il s’est rigidifié pour conserver la nation et le judaïsme qui en résulte est une écorce rigide dont Hess s’est lui-même détaché. Je ne sais si le christianisme a éclaté à la suite des Lumières, si le judaïsme a été plus robuste que le christianisme face aux Lumières mais lorsque le judaïsme éclate, c’est et comme religion et comme nation, la déjudaïsation conduit irrémédiablement à l’assimilation aux autres nations.
Ce qu’il faut aux Juifs, c’est et Israël et un épanouissement de la religion hors de son esprit de conservation. En Israël, cet esprit de conservation ne servirait plus à rien. « Moi-même, si j’avais une famille, et malgré mon hétérodoxie, je me déclarerais membre d’une communauté juive traditionnelle, j’accomplirais chez moi toutes les prescriptions. » (p. 124) Dissonance ou mauvaise foi. Pourquoi accomplir des prescriptions auxquelles il ne croit plus ? Le détachement de la religion est un revolver à un coup, il est intransmissible, ne fonctionne sincèrement que pour une seule génération, prétendre transmettre et le respect des pratiques et le doute méthodique quant à ces pratiques, c’est un faux-fuyant. Hess ne reconnaitrait pas ses enfants s’ils accomplissaient sincèrement toutes les mitzvot. Mauvaise foi parce que l’on peut bien accomplir toutes les mitzvot au conditionnel (« si j’avais une famille »). Goujaterie enfin, à l’égard de son ex-femme. On se prend à penser : si Hess n’avait pas raté son mariage mixte, le sionisme serait-il advenu ?
Je force le trait dans cette déception. Hess livre bien sûr quelques intuitions lumineuses en plus de poser concrètement la première pierre du sionisme moderne, ce qui me permet d’écrire tout cela aujourd’hui. Des intuitions contre les chimères rationalistes-humanistes du judaïsme réformé ou du diasporisme : « d’après eux, la dispersion des Juifs serait la vocation du judaïsme » (p. 139) ou encore « les prétendus bienfaits que les Juifs apportent au monde par leur dispersion me semblent exagérés “pour le besoin de la cause” (p. 140).
Non, répond Hess, le premier devoir moral est envers soi-même. « Ils s’ingénient à trouver des raisons fallacieuses à la survie d’une religion qui pour eux n’a plus aucune raison d’être » note-t-il avec malice, mais on pourrait lui renvoyer la même réplique pour qualifier sa révérence vis-à-vis de la tradition orthodoxe. « Ou bien il faut considérer l’humanisme comme le but et la raison fondamentale du judaïsme ; il faut alors lutter non pour un but national mais pour un but universel ; mais alors le judaïsme est destiné à se fondre dans l’humanisme universel. Ou bien on considère que le judaïsme apporte un salut véritable ; on se trouve alors en conflit avec les mouvements socialistes modernes. » (p. 143)
Hess entrevoit ici la possibilité d’un sionisme religieux, la croyance en un judaïsme n’ayant pas vocation à se fondre dans l’universel. Fort bien, mais alors il faut adhérer au judaïsme, sincèrement y adhérer, sincèrement croire que le particularisme juif se justifie par la vertu supérieure d’une voix juive – au sens religieux – dans le concert des humanismes.
Dans ce cas, un Samson Raphaël Hirsch semble correspondre à cette voie, Hess lui décoche ses flèches les plus acérées. Je pense au contraire que le particularisme juif, sioniste ou non, se justifie plus simplement : aucune collectivité ne peut souhaiter sa propre disparition (c’est ce qu’écrit Theodor Lessing dans la préface de La haine de soi), et le sionisme est la forme la moins mauvaise pour permettre la continuation du fait juif.
En sus, le sionisme a précisément la vertu de dépasser le conflit théologique entre orthodoxie et réforme, de réconcilier ce que l’on veut de l’un et de l’autre.« Le créateur n’a conçu dans l’Histoire que des peuples particuliers. […] Une fusion des religions ne suffit pas à établir une paix véritable entre les hommes. Pas davantage en partant de la foi en l’homme universel. » (p. 145)
En ce sens, le nationalisme juif de Hess est un humanisme humble. « La majorité dominante a déjà perdu son appétit de loup et la minorité opprimée n’a plus sa patience d’agneau. » (p. 189) anticipe-t-il, les revendications particulières des Juifs sonneront faux aux yeux de la majorité, à contretemps, et provoqueront des réactions embarrassées, le sionisme sera reproché aux Juifs quand les nations déjà constituées tiendront déjà le nationalisme pour acquis et chercheront à la dépasser.
Enfin, cette belle formule sur les humanismes français et juifs, de la part d’un Juif allemand francophile, que l’on retrouvera plus tard chez de nombreux israélites français pour célébrer la République française, vécue comme une sorte d’accomplissement de l’humanisme juif : « Les Français et les Juifs ! Le peuple français l’emporte sur le peuple juif par sa faculté d’assimiler tous les éléments étrangers à son être ouvert et universaliste. Le peuple juif est plus moral et plus sérieux que le peuple français, il imprime sa marque aux peuples étrangers et il accepte difficilement de les laisser transformer son être. » (p. 186)
|
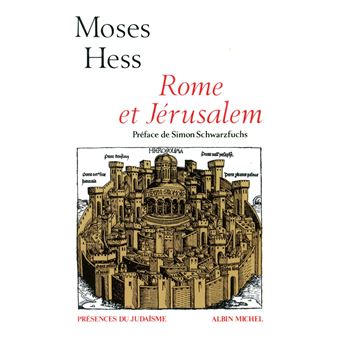


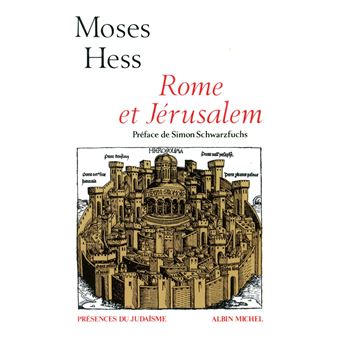


Poster un Commentaire