
Par
Albert BENSOUSSAN
Quand le vin est tiré et mis en bouteille, alors on y colle une étiquette. Tout ce que j’ai écrit et publié du côté de la fiction – et dont je n’ai pris conscience qu’après coup, n’ayant jamais noirci ma feuille que par hasard, par accident et sans y prendre garde – reçoit ici son label, ou disons son blason : “Écriture séfarade”.

Et moi, le solitaire, le rebelle reclus au loin – loin d’où ? –, moi, l’exilé à feuilles persistantes, je me retrouve aujourd’hui joliment entouré de gens que je lis et que j’aime, mes voisins de pupitre, mes collègues de plume, que je serre autour de moi comme la couverture de laine dont ma mère ceignait mes reins quand se prolongeaient mes soirées en veilles studieuses, dans cet Alger réputé chaud, sauf en hiver et à une époque antérieure à l’invention du chauffage central…
On avait bien essayé le canoun, et ses braises de charbon fumantes, parfois, dans le petit bureau vitré sur la véranda où je faisais mes devoirs avec papa, mais un jour on avait failli tourner de l’œil sous l’effet du gaz carbonique – on le sait, plus concentré l’hiver –, bref la seule façon de lutter contre l’oxyde de carbone restait la couverture de laine. Celle-là même que j’ai pieusement conservée, soigneusement pliée sous le matelas de ma chambre, malmenée, jaunie, mitée, comme une relique.
Un manteau de mémoire, une effiloche. Car c’est Lalla Sultana, la mère de ma mère, qui l’avait tissée en son jeune temps sur son métier à Nédroma, au large de Tlemcen.
Et je revois maman, en jeune fille accomplie, une fois l’an montant rejoindre les bergers à l’heure de la tonte sur les collines de Bné Ouarsous, où pépé Messaoud entretenait un petit troupeau de moutons. Alors elle rapportait de sa récolte ces grandes couffes de laine qui, ensuite, tiendraient lieu d’armoires dans nos chambres à coucher du village. Car la maison était carrée, dans le style de toute la Méditerranée lointainement romaine et présentement hispano-mauresque, et toutes les pièces donnaient sur la cour où nous mangions, été comme hiver, dans l’odeur du kemoun, du skin djebir, du kesbour, du zaafrane ou de la naana – ou disons cumin, gingembre, coriandre, safran, menthe.
Ai-je dit que mon grand-père Messaoud était l’épicier du village et qu’il me suffisait de passer la porte de sa boutique pour éternuer à tout vent, surtout si trônait à l’entrée, tout étripé, le sac de fefla kahla – cette kahla-là n’a rien à voir avec la Kahla Bruni qu’on connaît, encore que… l’une est brune et poivrée quand l’autre n’est que du poivre noir…

Je reviens à ma chambre à coucher de village, qui n’était qu’un petit carré avec ses touffes en coin, ses crins en bouffe, et ses matelas prisonniers qu’on dépliait la nuit pour dormir. Qui parlait alors de sommier ou de lit à montures de fer ?
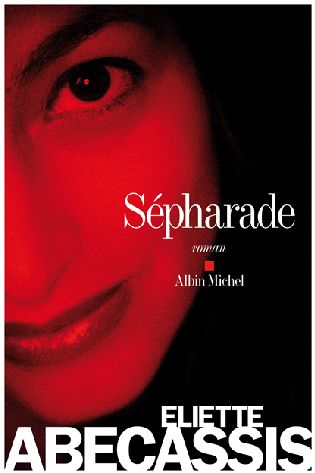
À Alger, oui, mon berceau était un lit-cage, et la grande couche de mes parents, sur lequel maman me mit au monde, était si haute et métallique, qu’elle devenait, en fait, sous le sommier, ma salle de jeux… Et je m’y cachais aussi quand j’avais peur, quand mon frère me poursuivait pour me faire mourir de chatouilles, ou quand tonton Salomon, le marin de Nemours, ou disons Ghazaouet, venait en visite, parce que c’était le plus grand de la famille, une espèce de géant tonitruant avec des moustaches à crocs fournis qui compensaient sa luisante calvitie : moi je l’observais, silencieux et craintif, sous mon dôme de laine.
En ai-je assez dit ? J’ai toujours écrit de cette façon gigogne, en déroulant le fil du récit, tout comme se dévidait la bobine de couturière de ma cousine Esther, qui tenait un ouvroir à Tlemcen, et dont la vie aujourd’hui, en lointain Finistère, ne tient plus qu’à ce brin de laine tremblant entre ses doigts devenus gourds. Et je garde précieusement cette kippa – ou disons calotte – de velours vert qu’elle m’avait offerte pour ma communion – ou disons bar-mitzva.
Mais la question posée est toujours sur la table : cette écriture est-elle séfarade ? Vous aurez tout compris. Risquons, néanmoins, quelques traits de séfaradité.
Est séfarade ce qui n’est pas ashkénaze. Donc écriture rieuse, ensoleillée, malicieuse.
Absence de mots passés au raifort ou au paprika, présence d’harissa et fefla hara, ou disons piment de Cayenne – que maman appelait, allez savoir pourquoi, “Mohamed”, et si l’on poussait un cri brûlant en avalant la première cuillerée de loubia bel ham, elle s’écriait en riant : Ada Mhamed kbir, et c’était toujours un gros piment entier nageant dans le brouet roux de haricots à la viande.
Le style séfarade s’encombre plutôt que de concombres au sel qui vous gonflent la tripe, de ces poivrons verts ou rouges, ou disons fefla hamra hloua, qu’on mettait à sécher sur la chaux des terrasses à Montagnac – ou disons Remchi –, au large de Tlemcen, et qui, en hiver, crépiteraient dans l’huile chaude de la poêle pour glouglouter ensuite dans nos boyaux.
Pas de gefiltefish, foin de carpe farcie, mais le bouzelouf ou tête de mouton grillée au canoun, ou alors les sardines à la scabetche – et là on entre en cuisine espagnole, mais en bannissant à tout jamais le halouf, qui est hlam et cochon chez nous. Mais escabeche, pour l’écrire comme il faut, est espagnol et donc séfarade, n’est-ce pas ?
C’est étymologique : Sfarad veut dire Espagne en hébreu – tout comme la France est Sarfat, ce qui fait des Sarfati des plus français que toi.
Or j’entends déjà l’autre savant, ou disons un quelconque ladino, drapé de pédanterie, qui me retire mon étiquette, ou disons mon blason, comme on arrache une étoile : seuls les Juifs de Turquie et de Bulgarie, clame-t-il à la cantonade, parce qu’ils jargonnent encore dans la langue de Cervantès, sont dignes d’être nommés séfarades. D’accord, va pour Elias Canetti, va pour Edgar Morin, mais qui nierait que nous fûmes nous aussi des marranes, des Espagnols chassés de Séville et de Gérone.

Les archives sont là, et mes deux patronymes, Benayoun et Bensoussan ― sous diverses graphies, Ibn Shoshan, Abenayone Abenxuxen, etc…― se retrouvent tous ensemble à Tolède au XIIe siècle, et puis on les découvre à Grenade, à Fez, ou à Majorque, dans ce vaste brassage de la Méditerranée.
Ne finassons pas, nous fûmes tous espagnols, à quelque degré que ce soit, qu’on nous appelle tochavim ou megorachim au Maroc, grana ou tounsa en Tunisie, autrement dit, s’il faut traduire, aristocrates ou bougnouls.
Je ne dis rien de l’Algérie, car elle n’existait pas sous ce nom, terre de pirates et de nomades – et de Mozabites. Bon, pour finir, mon père, dont la langue maternelle était l’arabe, avait coutume à la synagogue, de temps à autre, de s’isoler contre un pilier du Grand Temple de la rue Randon à Alger, et de psalmodier alors un piyyot judéo-espagnol qui disait : Tú eres nuestro Señor, Tú eres nuestro Padre, Tú eres nuestro Salvador – et que le rabbin Yéhouda Berdugo, natif du Maroc, un beau soir de Rennes m’a chanté.

Papa était autant séfarade qu’Albert Cohen, qui descendait de la Reine Isabelle la Catholique, comme il l’écrit malicieusement, par un “ami” du Roi ― était-ce Abraham Senior ?
Albert Cohen qui chanta cette copla aux oreilles ahuries de Jacques Chancel lors d’une célèbre Radioscopie : A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, ay la esperanza me mantiene – “Sur la mer je suis allé chercher des oranges, chose que la mer ne contient, hélas ! l’espoir me soutient“, chant de l’impossible amour et du possible espoir.
Et voilà comment j’ai fait de la langue espagnole ma profession.
Qui a dit que je n’étais pas séfarade ? Au demeurant, les Juifs dans l’Espagne d’avant l’expulsion parlaient trois langues, comme dans la fameuse école de traduction de Tolède : l’espagnol, l’arabe et l’hébreu.
Et l’arabe est autant de Sefarad que l’espagnol. Restons-en là.
L’écriture séfarade est comme un fil qui se déroule, elle est anarchique et folle, “un peu nègre”, disait Albert Cohen, volontiers fardée et surchargée. Avec de sonores métaphores et d’excessives images. Nous ignorons la mesure, la retenue, l’exigence rationnelle.
Notre territoire est le rêve et fut la Jérusalem céleste avant le temps du Yichouv et de l’État d’Israël. Notre langage est plutôt crasseux, ou disons débraillé, nous parlons et papotons à l’envi, sans cesse, sans frein, inlassables et lassants, jamais cassants. Mais je m’aperçois que je n’ai rien dit de ce que j’ai écrit, et n’ai même pas cité le moindre titre.
Tant pis, nous sommes bavards, mais pas vains…

Albert Bensoussan



Toujours un plaisir de te lire, cher Albert, fin connaisseur de notre culture juive, aussi bien l’ashkénaze que la séfarade.
Pourquoi faut-il qu’il se déclare “sépharade”?
A-t-il besoin de brandir des drapeaux car la qualité propre de ses écrits ne suffit pas à elle-même?
Imagine-t-on Philip Roth (exemple parmi tant d’autres), ashkénaze si l’on est, se définir comme tel?
Il est de notoriété publique que les Juifs, selon leur provenance géographique, cultivent les us et coutumes de leurs parents et ancêtres, appelés Minhaghim. Ca n’a rien à voir avec des “drapeaux”, sauf pour des personnages assez crispés.