« Cela s’est produit, donc cela peut se reproduire. » — Primo Levi
Le 14 décembre, l’Australie a été secouée par une fusillade qualifiée d’« acte d’antisémitisme maléfique » par le Premier ministre Anthony Albanese. Un bilan humain effroyable — annoncé comme atteignant douze morts selon des mises à jour successives — qui rappelle une vérité qu’on voudrait ne jamais avoir à redire : l’antisémitisme frappe encore, et il tue. Et quand il tue, il ne tue jamais “par accident”. Il vise une identité, une mémoire, une présence. Il vise le droit d’exister sans se cacher.
Mais il y a quelque chose d’encore plus insupportable que la violence brute : c’est l’hypocrisie qui l’entoure. Le spectacle désormais ritualisé de responsables qui « condamnent avec la plus grande fermeté », tout en ayant, hier, nourri l’atmosphère morale et politique où cette haine devient respirable. D’où cette impression glaçante : des pyromanes qui se présentent en pompiers. La main qui attise, puis la main qui pleure. La phrase qui relativise, puis la phrase qui déplore. Le message qui brouille, puis le communiqué qui s’indigne.
Car l’antisémitisme moderne prospère rarement sous la forme caricaturale qu’on aime dénoncer. Il prospère sous une forme beaucoup plus acceptable : l’antisémitisme devenu « compréhensible », « contextualisable », « nuancé », « excusable », fondu dans un récit où l’on croit faire preuve de courage moral en désignant, une fois de plus, le Juif — ou l’État juif — comme l’exception, le suspect, le coupable commode.
L’indignation sélective, ou le moment où la morale devient une arme
Le monde contemporain a fabriqué une indignation à géométrie variable : fulgurante ici, muette ailleurs ; féroce contre certains, indulgente envers d’autres ; intraitable quand il s’agit d’Israël, timide quand il s’agit de tant de tragédies comparables, parfois pires, souvent plus longues.
On objectera : “ce n’est pas de l’antisémitisme, c’est de la politique”. C’est précisément là que réside le piège. L’antisémitisme du XXIᵉ siècle ne se présente plus comme une haine du Juif en tant que Juif ; il se présente comme une pureté morale. Et il a appris un art terrible : transformer sa cible en accusée. Faire de l’insécurité juive une conséquence “compréhensible” d’un contexte. Faire de la peur juive un “détail”. Faire du meurtre d’un Juif une tragédie… puis une parenthèse.
Or une société se juge à ses réflexes. Et quand les réflexes sont tordus — compassion conditionnelle, indignation sélective, courage intermittent — la société se prépare, malgré elle, à l’irréparable.
Le boycott acte: symbole d’une Europe malade
L’Europe, berceau historique du fléau, prétend l’avoir vaincu. Mais elle en conserve les vieux réflexes. Le Concours Eurovision n’est qu’un symptôme : l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la Slovénie et l’Islande n’hésitent pas à s’engager dans un boycott acté et effectif d’Israël.
Chacun invoque sa vertu. Chacun se drape dans des principes. Très bien : les principes sont nécessaires. Mais le problème n’est pas l’existence d’un principe ; le problème est l’usage asymétrique du principe. Pourquoi ce zèle d’exclusion se déclenche-t-il si vite contre Israël, et si rarement contre tant d’autres acteurs, tant d’autres violences, tant d’autres cynismes ? Pourquoi ce besoin récurrent de désigner le même coupable symbolique, comme si l’Europe cherchait — consciemment ou non — une vieille figure d’expiation ?
L’Eurovision, dira-t-on, n’est qu’un concours. Non. C’est un miroir. Un thermomètre. Un signe. Et ce signe dit quelque chose : au lieu de soigner ses pulsions anciennes, l’Europe les recycle dans le langage contemporain de la vertu. Elle ne dit plus “je hais”, elle dit “je boycotte”. Elle ne dit plus “je rejette”, elle dit “je sanctionne moralement”. Et elle s’imagine ainsi purifiée.
Ce qui est insupportable, ce n’est pas la critique d’un État. Tout État est critiquable. Ce qui est insupportable, c’est la fixation, l’obsession, l’exceptionnalisation. Le moment où le Juif redevient l’unique question morale du monde. Le moment où l’on retrouve, sous des mots nouveaux, un mécanisme ancien : désigner le Juif comme problème à résoudre.
France: quand le sommet de l’état envoie des signaux ambigüs
En France, le problème n’est pas l’absence de mots ; nous en produisons beaucoup. Le problème est la cohérence. Car il est possible de condamner l’antisémitisme à la télévision et, dans le même mouvement, de multiplier les séquences politiques qui brouillent, désorientent, humilient, ou laissent entendre que la colère contre les Juifs serait une variable “compréhensible” du débat public.
On doit écrire : « Macron ne peut plus se racheter. » Ce que nous visons : non pas une personne, mais un ensemble de signaux que beaucoup ont vécus comme des renoncements, des maladresses répétées, ou des ambiguïtés lourdes de conséquences. Nous devons lister des faits et des séquences que nous estimons irréparables. Dans une tribune, l’essentiel est de transformer cette colère en accusation politique plutôt qu’en procès d’intention — car c’est politiquement plus solide, et moralement plus imparable : ce ne sont pas les âmes qu’on juge, ce sont les effets
• L’absence notée : ne pas marcher (ou donner l’impression de ne pas vouloir marcher) quand une partie du pays se lève contre l’antisémitisme envoie un message — surtout dans un moment de tension.
• La “double allégeance” : évoquer ce thème, même par maladresse, réactive une vieille rhétorique qui colle à la peau des Juifs depuis des siècles : “ils ne seraient jamais vraiment d’ici”. C’est un poison historique ; on ne joue pas avec.
• La délégitimation symbolique : toute phrase qui réduit la naissance d’Israël à une formule technocratique ou froide peut être perçue, à tort ou à raison, comme une manière d’ôter à cet État son épaisseur existentielle — et donc de fournir des arguments à ceux qui rêvent de le nier.
• L’accusation extrême : laisser planer l’idée d’un crime absolu, sans précaution ni rigueur, produit un effet concret : cela descend dans la rue, sur les campus, dans les insultes, dans les menaces. La parole publique a un poids ; elle doit mesurer ses mots quand les rues s’embrasent.
• Le risque de “récompense” symbolique : toute initiative diplomatique qui semble récompenser un récit d’agression peut être vécue comme une injustice morale, et alimente la perception que la violence paie.
Nous devrions dire avec une formule brutale : “complice, catalyseur”. Disons-le de manière politiquement indiscutable : quand l’État brouille ses signaux, il affaiblit la digue. Et quand la digue faiblit, les fanatiques n’ont plus besoin d’être nombreux. Il leur suffit de sentir que l’air est devenu permissif.
L’erreur de la « réhabilitation »: une marche ne lave pas une ligne
Dans ce contexte, l’idée d’inviter Emmanuel Macron à “conduire” une marche contre l’antisémitisme — comme cela a été évoqué par Serge Klarsfeld — pose une question stratégique autant que morale : une marche peut-elle corriger une ligne ?Une marche est un symbole. Elle n’a de sens que si elle s’inscrit dans une continuité nette : protection réelle, justice rapide, sanctions, discours sans ambiguïté, refus clair des renversements accusatoires, fermeté contre les prêcheurs de haine, et surtout constance.
Sinon, la marche devient un objet dangereux : elle peut se transformer en opération d’image, en tentative de rattrapage, en photographie historique — pendant que, sur le terrain, la peur demeure et la haine prospère.
Le temps des pseudo-vertueux doit cesser. Ceux qui pleurent l’incendie ne doivent pas avoir, la veille, distribué des allumettes. Ceux qui dénoncent la haine ne doivent pas avoir, hier, excusé ses récits.
Ce que Sydney nous crie
Sydney n’est pas un « ailleurs » exotique. Sydney est un avertissement universel. C’est le rappel que la haine n’a pas besoin d’un siècle pour revenir ; elle a besoin d’un climat. Elle a besoin d’une permissivité morale. Elle a besoin d’une culture de l’excuse.
Et c’est ici qu’il faut être d’une clarté totale : l’antisémitisme n’est pas une opinion. Ce n’est pas un « dérapage ». Ce n’est pas une « tension ». C’est un signal d’effondrement. Le moment où une société accepte que certains vivent avec une cible dans le dos.
Primo Levi a écrit, après l’abîme : « Cela s’est produit, donc cela peut se reproduire ».
Aujourd’hui, cela se reproduit. Et l’époque des demi-mots est terminée.
Honte à ceux qui, par calculs, par lâcheté ou par vertige moral, ouvrent la porte à un fléau que l’on croyait condamné. Et respect — enfin — pour ceux qui exigent une chose simple, universelle, non négociable : que les Juifs puissent vivre, partout, sans peur.
© Richard Abitbol
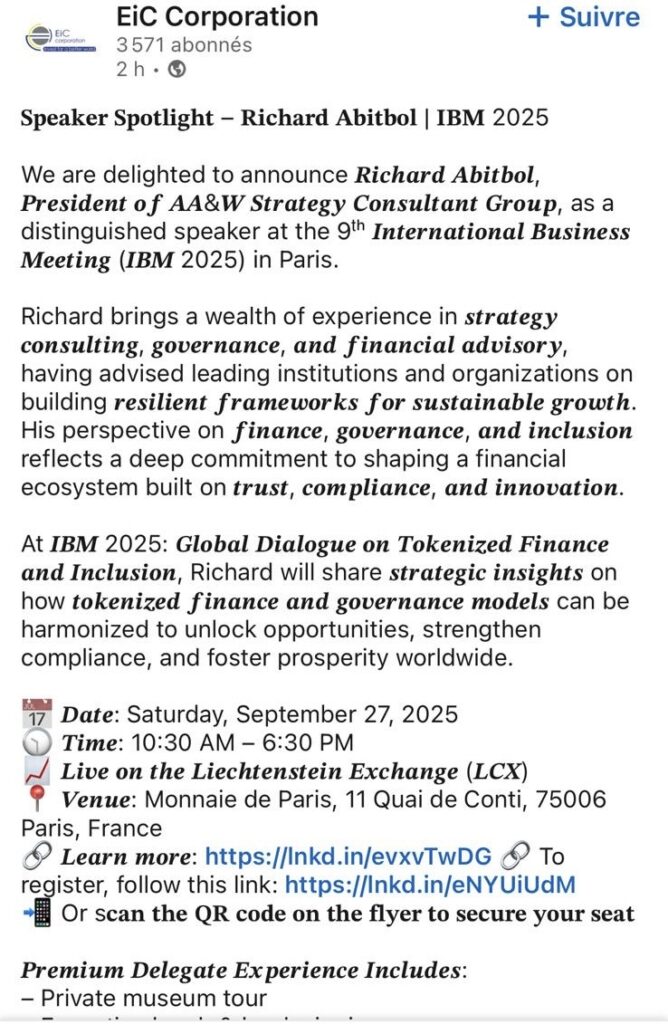


il faut le dire et le redire
l antisemitisme est un délit
et il faut le condamner mais
également le combattre
malheureusement nous ne disposons que de quelques armes
alors il faut inventer ce qui va nous permettre
à endiguer cette vague .