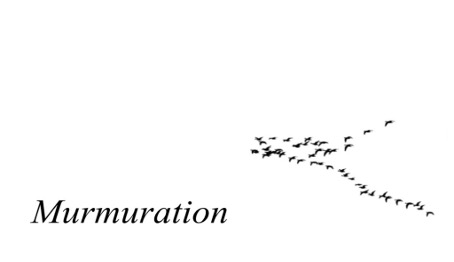Interview Alain (Georges) Leduc, autour de son ouvrage
Yves Klein ou la Pureté du Pur
Par Daniella Pinkstein.
Pour Tribune Juive.
Alain Georges Leduc, vous êtes écrivain, professeur dans plusieurs écoles supérieures d’art, critique d’art renommé, historien, poète, vous avez écrit de très nombreux livres, certains inclassables, mais tous très érudits. Votre dernier ouvrage est, quant à lui, particulièrement inattendu. Yves Klein ou la Pureté du Pur est en effet l’un de vos ouvrages les plus stupéfiants pour un public non averti. Yves Klein et « son fameux bleu outremer », ce peintre si aimé, si cité, présenté comme l’artiste le plus novateur de son époque, est tamisé littéralement par votre enquête scrupuleuse jusqu’au dernier pigment. Et il nous reste, page à page, un tout autre Klein : procédurier, mythomane, cupide, misogyne, admirateur du fascisme, se vantant de posséder Mein Kampf comme livre de chevet. Un imposteur total.
A.(G). L : Vous auriez pu ajouter « vénal ». Bizness as Bizness, selon leur langage. Obsédé d’ésotérisme, rosicrucien, terre-platiste… Tout pour plaire. Klein représente, comme Andy Warhol (les deux hommes ne se sont juste croisés qu’une fois, à New York) l’une des plus grandes escroqueries du système de l’art contemporain. Adulateur de Sainte-Rita de Cascia, vénérée par les ultra-catholiques. J’ai dégoté dans les archives, à Madrid, sa carte d’accréditation de la phalange, lorsqu’il fut l’entraîneur, au judo, des gardes du corps de Franco.
- Tout d’abord, pourquoi avoir porté votre intérêt sur ce peintre en particulier, quelles raisons au départ vous ont poussé à réaliser ces recherches?
A.(G.) L. Par un retournement progressif, comme il s’en opère parfois dans la vie. Comme enseignant généraliste d’histoire de l’art, au début de ma carrière, j’étais tenu à des passages obligés, comme le furent – je n’indique pas leurs dates – les ordres grecs, les cathédrales gothiques, Palladio, ou Le Corbusier et sa villa Savoye. Yves Klein en faisait partie. Je le considérais alors indéniablement, en toute bonne foi, comme l’un des artistes les plus précurseurs de son temps. Puis, progressivement, tout s’est détricoté.
Le point de déclic fut la salle du personnel du centre Georges-Pompidou, un tract punaisé sur le traditionnel panneau d’affichage syndical fixé au mur, dans les vestiaires, qui nous servaient de loge, pour s’habiller, se préparer, prendre un café, les étudiants et moi. Le second jeudi du mois (ils appelait cela les jeudi’s), le Centre Beaubourg invitait une école d’art à investir le Musée national d’art moderne pour provoquer des micro-évènements, performances, lectures devant de œuvres, à suivre au fil de la soirée. J’avais été chargé, pour l’école supérieure de Lorraine, de cornaquer le groupe. « Le public saura-t-il que nous nous préparons à abriter l’exposition d’un adulateur d’Hitler ? », s’y interrogeait l’une affichette. Mon ami Pierre Bourgeade (1927-2009), depuis disparu, était présent, ce soir-là.
- Cette enquête menée avec tant de méticulosité fut-elle aisée, ou les écueils ou obstacles furent-ils au contraire très nombreux?
A. (G.) L. : L’institution accepte mal qu’on lui crache au visage, qu’on dévoile, preuves à l’appui, son incurie.
Pourtant, une universitaire de Columbia, Nuit Banai, avait déjà levé le lièvre, avec son Yves Klein (en anglais, 2014), non encore, – le barrage étant tel ici –, traduit en français. Après, ce n’est que du travail d’enquête, d’archives, il ne suffisait plus que de dérouler le fil de l’écheveau.
- Quel est le parcours exact d’Yves Klein et qu’est-ce qui explique, selon vous, son succès? Pourquoi Yves Klein a-t-il en quelque sorte si bien fonctionné?
A. (G.) L. : Le contexte l’époque, les Beatles, les cheveux longs, les jupes courtes. Après les années d’apprentissage du judo –, précisons qu’il n’était pas juif, comme dans le cas de Monsieur Klein, de Joseph Losey (1976) –, le parcours artistique, très court, du jeune Klein se construisit sur seulement huit ans (1954-1962). Comme James Dean (1931-1955), il fascina par sa jeunesse. Mais en anti-Rimbaud absolu. 1954-1962, c’est exactement la guerre d’Algérie. Une totale concomitance. La société française a eu envie d’en sortir. Le parallèle avec Andy Warhol (1928-1987) est frappant. Alors qu’il était encore complètement inconnu, à Muriel Latow (1931-2003), jeune galeriste qui lui demandait ce qu’il aimait le plus au monde, Andy Warhol répondit sans hésiter : « L’argent ». « Peins donc de l’argent, des billets d’un dollar », lui aurait-elle conseillé. Andy non seulement s’exécuta avec profit (c’est le cas de le dire), mais poussa jusqu’au bout son raisonnement dérisoire, soulignant la réalité commerciale de l’art.
- Qu’avez-vous immédiatement décelé ?
A. (G.) L. : Il était abject avec les femmes. D’une stupéfiante misogynie. Je démontre aussi son racisme viscéral, notamment à l’égard des Noirs.
- Comment expliquez-vous que si peu, voire pour ainsi dire rien, de ce que vous révélez sur ce peintre ne fut mis en lumière dans les études le concernant? Pourquoi cette cécité? Volontaire? Grégaire? Ou s’agit-il d’une duplicité identique à celle d’Yves Klein, dans l’air du temps, d’un temps hypocrite et cabotin qui annonce notre propre cécité?
Est-ce que l’art peut échapper à l’idéologie? et l’art pictural en particulier?
A. (G.) L. : Selon une formule confirmée, l’anti-idéologie, c’est déjà, et surtout, de l’idéologie. Tout est idéologie. Surtout l’esthétique, qui n’est jamais neutre. La grande affaire pour moi, aujourd’hui, c’est le roman, qui de Don Quichotte (1605), via Marelle de Julio Cortázar (1963) ou d’ Extinction, de Thomas Bernhard (1986), n’a conquis sa spécificité de genre et son modèle narratif propre qu’à la suite d’une lente maturation. Gilles Deleuze (1925-1995) et Félix Guattari (1930-1992), l’exposent ainsi dans Mille plateaux : « Le monde est devenu chaos, mais le livre reste image du monde, chaosmos-radicelle au lieu de cosmo-racine ». Le roman contre contre-monde, la littérature donnante une forme à la totalité du monde.
- Cette recherche détaillée autour d’Yves Klein, hélas, révèle aussi, comme un sinistre tour de piste, toutes les compromissions d’après-guerre, ces angles aveugles qui ont continué à pénétrer l’art et le monde politique et financier l’enveloppant. Sommes-nous toujours les héritiers complices de cet art?
A. (G.) L. : Plus que jamais. Nous y sommes enferrés. Jacques Derrida m’incite néanmoins à déconstruire, notamment le cinéma, la photographie, spécifiquement en noir et blanc. J’ai fréquenté Marc Garanger (1935-2020), à Paris et en Normandie, l’homme des visages dévoilés des vieilles femmes kabyles; Sergueï Paradjanov (1924-1990), chez lui à Tbilissi; et Willy Ronis (1910-2009), en Arles, chez lui à Paris, ou dans sa galerie de Belleville. Nous devons de nouveau renverser les paradigmes.
- La critique marxiste, puis de « gauche », certes longtemps érudite, s’est ingéniée à classer l’art dans la catégorie des expressions bourgeoises, pensant peut-être l’expurger de son passé, ou cherchant à briser les idoles. Cette tendance ne s’est-elle pas dissoute aujourd’hui dans un verbiage nous valant ces pitreries incultes actuelles d’une gauche « anticolonialiste », « woke », « genrée, en i.l avec ou sans e. » L’art n’en a-t-il pas subi les conséquences? Et pourquoi, hélas, en toute connaissance de cause, l’art et les historiens de l’art tendent quelquefois à accentuer cette dérive?
A. (G.) L. : On boit du petit lait, avec vous. Votre dernier mot, « dérive », est un peu faible. Dans le plan qu’il se donne pour sa critique de l’économie politique, Karl Marx, en 1859, prend l’exemple de la production artistique pour y dénoncer à la fois les idées de « modernité » et/ou de « progrès » sous leurs « formes abstraites habituelles » coutumières des historiens de l’Art, comme celles que privilégient les idéalistes de la « forme », aussi bien que celles des adeptes du « matérialisme naturaliste ». J’en tiendrais plutôt pour un habitus, comme l’évoque Pierre Bourdieu. En sociologie, un habitus désigne une manière d’être, une allure générale, une tenue, une disposition d’esprit.
- L’effondrement actuel de la connaissance – dans tous les domaines, historique, littéraire, culturel, effondrement fracassant, entraîne-t-il dans sa chute le monde de la création? et la réflexion autour et par elle?
A. (G.) L. : La modernité nous a menés ici. Entendu au bord du gouffre. Aux oligarchies financières et guerrières. Le bourrage de crâne, la servitude volontaire d’Étienne de la Boétie comme seules doxas. Mon ami Bernard Noël, récemment décédé lui-aussi, avait réglé à sa manière la question du sens. Il écrivait « censure » « sensure ». Il ne faut plus penser contre les autres, mais penser plus que jamais contre soi.
- À des époques charnières de l’histoire, les arts plastiques n’ont-ils pas été un contrepoison aux dérives idéologiques, aux risques de glissements vers ces espaces vides, incarnés aujourd’hui, par exemple, par ces TikTok et autres réseaux basés sur un visuel aussi tonitruant, obsédant que décervelant? Où se situe aujourd’hui ce contre-poids artistique?
A. (G.) L. : Vous faites les réponses à ma place, avant même que je n’esquisse leur formulation. Cela nous permet de gagner du temps, et me permet de vous répondre brièvement. Les « réseaux sociaux », je les qualifie de « réseaux asociaux ». Ils ne représentent aucunement une pensée collective. Nous vivrions, autant utiliser des italiques dans votre retranscription, les derniers jours avant la mort de l’art. La mort de Dieu, on connaît la date, grâce à Nietzsche et son Zarathoustra, presque à la minute près. Dans toutes ces vacuités, les atrocités qui s’enchaînent actuellement c’est la perte du sens, de la langue qui sont centrales. La religion est incompatible avec la vision rationnelle, scientifique à laquelle l’art, si, lui, est conciliable.
- L’art contemporain actuel s’est-il inspiré d’une certaine manière de Klein? De son art également fallacieux de faire passer des vessies pour des lanternes? Existe-t-il du reste un art dit contemporain?
A. (G.) L. : Pop art, Op art, Body art, Land art, « happening », etc. – , des mots ou des expressions anglo-saxons à la clef comme « cortesy », ou « save the date », tout y est dit implicitement, déjà. La terminologie le dit bien. La domination du marché. Je préfère parler d’« art officiel » plutôt que d’« art contemporain ». L’État ne devrait jamais à devoir subventionner l’art. L’art doit être libre, pas asservi. Ni par le marché, ni par le religieux, ni par l’État.
- Puis-je vous demander sur quel autre artiste travaillez-vous actuellement?
A.(G.) L. : Je viens d’achever un « Jules Verne (1928-1905), figures de l’anarchie », qui paraîtra cet été, et me remets à un gros essai laissé en jachère sur Sylvain Maréchal (1750-1803), un des grands intellectuels de la Révolution française. Je poursuis parallèlement mensuellement mes chroniques sur l’art, dans « La Raison », le magazine mensuel de la Fédération nationale de la Libre Pensée et la Tribune des athées. Là, je viens d’y écrire sur Paul Rebeyrolle (1926-2005), Monique Dollé-Lacour (née en 1946), sur le Rembrandt de Jean Genet (1910-1986), et y ait fait pour un grand public une relecture de la mort de Bergotte, de Proust.
L’image, chez Verne, qu’elle soit peinture, métaphore littéraire, ekphrasis, représente le réel au point parfois de se substituer à lui.
Dans le Nautilus, il ne manque que des flabella de Brustolon, parmi les Delacroix, les Ingres, les primitifs flamands ou Italiens. « Une madone de Raphaël, une Vierge de Léonard de Vinci, une nymphe du Corrège, une femme du Titien, une adoration de Véronèse, une assomption de Murillo ». Bien éloquente est la liste des peintures, des tableaux, dans l’habitacle du capitaine Nemo.… S’il n’y a pas de sculpture, c’est faute de place.
- Et dernière question, plus personnelle. Nous partageons collectivement le sentiment d’une époque « en pente », devant laquelle on ne sait s’il faut s’attendre au chaos ou à un renouveau total. Que peut-on attendre aujourd’hui de l’Art? qu’attendez-vous de l’Art? Peut-on du reste poser une telle question, a-t-elle encore un sens pour quiconque?
A. (G.) L. : Nous traversons en effet une assez sale période de basses eaux. Je suis en délicatesse avec mon temps, voyez-y un euphémisme. La bêtise s’améliore, selon le très beau titre de Belinda Cannone (née en 1958). Cela n’a pas débuté hier. La pensée unique, la droitisation de toute une société. Cette bêtise que vomissait par-dessus tout Gustave Flaubert. Cela risque de durer, de perdurer, cette destruction qui se fait sciemment de notre littérature et de notre langue. Mais je ne m’en fais pas. Ce sont Boris Pasternak (1890-1960), Anna Akhmatova (1889-1966) et Nadejda Mandelstam (1899-1980) qui ont eu in fine la peau de Staline.
Alain (Georges) Leduc, écrivain, critique d’art et socio-anthropologue (membre de l’Association internationale des Critiques d’Art (A.I.C.A.), de l’Association internationale des Sociologues de Langue française/A.I.S.L.F.) et de l’Association française des Anthropologues (A.f.A.), a obtenu le prix Roger-Vailland, en 1991, pour son second roman, Les Chevaliers de Rocourt. Il est l’auteur d’un volumineux dictionnaire des terminologies artistiques, Les mots de la peinture (chez Belin, coll. « Le français retrouvé ») et a publié un ouvrage – Résolument moderne – sur les céramiques de Paul Gauguin. Il a collaboré au Dictionnaire des sexualités (chez Laffont, coll. « Bouquins »), sous la direction de Janine Mossuz-Lavau (Cevipof, Sciences Po/Paris) et collabore à l’Encyclopédie de la colonisation française, sous la direction d’Alain Ruscio. Auteur d’un essai biographique consacré à l’écrivain Roger Vailland, Un homme encombrant, son roman érotologique Vanina Hesse a été republié en poche, coll. « Lectures amoureuses », à la Musardine. Membre de la société des Amis d’Octave Mirbeau, il a livré un Octave Mirbeau, le gentleman-vitrioleur, aux Éditions libertaires. S’en est ensuivi, chez le même éditeur, une biographie et la publication des Œuvres complètes, sous coffret, en trois volumes, de Gaston Couté.
Du même auteur, aux éditions Delga, Art morbide? morbid art. De la présence de signes et de formes fascistes, racistes, sexistes et eugénistes dans l’art contemporain.
Il vient de publier un Yves Klein, un fasciste européen, aux éditions de la Librairie Tropiques (diffusion Librairie philosophique Vrin).