« Tout est justiciable », le principe édicté[1]par le juge Aharon Barak a toutes les caractéristiques de la vertu.
Si tout est justiciable, en effet, tout est donc régi par la justice, le pouvoir judiciaire- et doit l’être – de sorte qu’il n’y ait plus d’injustice. Le problème, c’est ce « tout». Il implique que toute la variété de l’existence soit ramenée à l’instance judiciaire, une justice qui serait de ce fait nécessairement transcendante et absolue. Rien ne lui échapperait…
Cependant, le principe ne nous dit pas ce que veut cette justice, ni qui elle est pour ainsi incarner le « tout » sans besoin de se « justifier » (puisque tout est ramené affirmativement à elle qu’est supposé incarner – et concrètement – celui qui l’édicte). Derrière le « Tout » de la matière justiciable, se tient donc un « Un » qui s’arroge le droit de rendre compte de « Tout », de sa propre initiative. Mais qui est ce « Un « qui « juge », qui dit qu’il est la source intrinsèque du droit et, en même temps celui qui l’applique ?
Jusqu’alors le droit n’était pas auto-institué. Son domaine était inscrit et limité dans une constitution décidée par le peuple et non les juges. De même, le juge ne pouvait pas se saisir lui-même d’une affaire : il fallait solliciter une telle démarche, citoyens ou parlement ou président.
En effet, en théorie démocratique, le champ judicaire est fondé sur le socle législatif. Seul le parlement peut dire ce qui est objet de jugement en vertu d’une constitution dont il est l’auteur. C’est le parlement qui écrit la loi et c’est le jeu de l’exécutif et du judiciaire qui est en charge de l’appliquer.
Le judiciaire n’est pas une fin en soi. Affirmer que tout est justiciable, et se ramène au pouvoir des juges tient du coup d’Etat du pouvoir judiciaire[2] qui supposerait que ses représentants et détenteurs le détiennent dans l’absolu et de toute éternité, dont il serait une incarnation pratique. Imaginez ce que l’on dirait si l’on affirmait aujourd’hui que tout dans l’Etat doit être soumis à la Halakha, une doctrine découlant de la révélation et des juges rabbiniques qui l’incarnent dans le cadre de la transmission de la Loi depuis Moise. « Tout est justiciable » suppose que le juge peut s’emparer de tout sujet et rendre un jugement définitif, sans en rendre compte à quiconque.
Et de fait, ce principe entraine la guerre de chacun contre tous : ce qu’est devenue la scène israélienne. Il n’est question que de conflits, de procès, d’avocats, de contestations. La controverse est permanente. Les avocats sont omniprésents. La vie commune est devenue un enfer de querelles et de contestations, de bouc-émissarisation alors que le pouvoir judiciaire s’est lancé dans une guerre contre le pouvoir législatif (le parlement et le principe de majorité d’où, en démocratie, émane tout pouvoir et donc celui de définir ce qui est « justiciable »), et contre le pouvoir exécutif, quand le tribunal intervient par exemple dans des questions de politique internationale et de stratégie militaire, là où tout relève uniquement du pouvoir exécutif issu du parlement et de l’élection.
Hakol shafit,c’est la guerre de chacun contre tous avec un pouvoir judiciaire dont l’autorité n’émane plus du peuple mais d’une quasi théocratie, en tout cas d’une « juristocratie »…
Cet état de fait est doublement problématique quand il est question de la morale juive. Il y a en effet toute une tradition concernant l’instance du droit. Qu’on se rappelle à ce propos les conseils donnés à Moise par Jethro concernant l’exercice du jugement. La justice telle que la conçoit le juge Barak est l’antithèse de la morale juive, l’antithèse des principes de gouvernement du peuple juif.
Car tout n’est pas justiciable.
Cette idée se trouve affirmée dans un dicton issu de la tradition juive pour définir les rapports qui font le peuple juif. « Kol Israel rakhmanime hem », « Tout » (on a vu la portée de ce « Tout ») Israël (les Juifs) sont miséricordieux ». On n’a pas assez médité cette parole pourtant couramment citée, de même que l’expression « les Juifs sont « miséricordieux, fils de miséricordieux » (Rahmanim bene rahmanim).
Il faut comprendre ces jugements moraux au plus près de l’étymologie. Rahamim, la miséricorde, un mot compris en général dans le sens de hemla, la compassion, doit être compris comme une vertu qui désigne le rapport du rehem (la matrice, l’utérus) au oubar, (l’embryon). La matrice dans ce contexte désigne ce qui porte le prochain et dont la finalité, la vocation, est de « faire place » à chacun. Faire place suppose qu’on se retire du « Tout », de l’ambition de tout saisir, de tout dominer et qu’on laisse le reste en suspens pour que l’embryon à naitre puisse « passer » (laavor) comme la Divinité « passe dans ses attributs devant Moise (Ex 34, 6).
Nous avons là un principe cardinal pour gouverner la cité juive, en tous cas ses mœurs, à l’image de la création divine, d’une Divinité qui, bien que son nom soit forgé sur le radical du verbe être, s’est retirée pour faire place à un second être, l’homme. C’est de l’ensemble de tous ces retraits successifs des uns envers les autres que le commun est constitué.
Nous ne sommes plus dans une logique du Tout (tout est…) ni de l’attribuable à une seule source mais dans une logique de la naissance, de l’avènement.
POST SCRIPTUM :
Le coup de force « juridico-politique » de l’ancien chef de la Cour suprême repose sur un ensemble de dispositifs qui s’inscrivent dans une série de relais très identifiables : le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique, la police, certains milieux de l’armée et des services secrets, (le Shabak, comme on l’a vu récemment à l’occasion de la démission problématique de son chef Ronen Bar). Son objectif est de paralyser l’action du gouvernement de droite (la coalition élue démocratiquement et qui a la majorité au parlement) et avant tout celle de son chef, le premier ministre Netanyahou.
La manœuvre procède en créant dans les allées du pouvoir toutes sortes de contentieux juridiques, avec leur contrepartie policière, qui, la plupart du temps, s’avèrent fictifs et sans fondements, mais qui, en même, occupent la scène, entravent l’action du gouvernement élu et l’empêchent de conduire la politique pour laquelle il a été élu, en une période où l’Etat d’Israël a dû se battre sur 7 fronts. Ces manipulations auraient été sans lendemain si elles ne bénéficiaient pas de la caisse de résonnance de la quasi-totalité des médias, politiquement engagés (le succès phénoménal de la nouvelle chaine 14, marquée à droite, aujourd’hui prédominante aux yeux de l’opinion publique sur le plan de la crédibilité de l’information, témoigne de cet état de fait).
Au cœur de la structure idéologique de ce syndrome, se déroule une chasse au bouc émissaire dans la personne de Netanyahou. Une haine féroce le poursuit de la part d’une série de « has been » (les cheavarim, en hébreu), ex-titulaires de fonctions et de titres, des chefs de ce qui reste des partis de gauche – l’ancienne élite, en somme – aujourd’hui à la retraite et qui, morts de de ressentiment personnel, l’attaquent de façon systématique en le portraiturant comme un danger pour Israël et pour la « démocratie » et en appellent à sa démission, à ce qu’il reconnaisse au moins sa culpabilité si jamais le président le graciait comme Trump lui en a fait la demande en public. Cette poursuite à mort du bouc émissaire en est venue à décider de l’affiliation politique. Tout le débat politique se joue ainsi entre les « bibistes » et les « anti-Bibi ».
La traque du premier ministre n’aurait rien été sans les procès pour corruption qui le poursuivent les uns après les autres et qui s’avèrent, successivement vides, mais obligent le premier ministre -en temps de guerre vitale pour le peuple juif- à se rendre trois jours par semaine au Tribunal. Cette « cérémonie » donne effectivement un semblant de réalité aux accusations de prévarication qui frappent premier ministre dans ses fonctions. Cela retentit bien sûr sur l‘exercice de ses attributs gouvernementaux qui sont bloqués à la convenance du système judiciaire. C’est de façon inverse que l’ex-président de la Cour suprême a voulu faire récemment des effets de style temps en lançant que nous avons perdu avec le régime en place notre qualité de « citoyens » pour devenir des « sujets » soumis à un seul homme, Netanyahou, dans ce qui est devenu une « dictature ». Ce qui est plutôt fort de café…
Le mouvement populaire qui au départ a porté cette crise fut très organisé, identifié, doté de moyens financiers conséquents (notamment le soutien financier des Etats-Unis de Biden). Il prit pour nom la « protestation » (mekhraa), menant manifestations et agitation dans un quartier de Tel Aviv (la rue Kaplan, d’où le nom de « kaplanistes »). L’objectif originel de la protestation visait à effacer la victoire aux élections de la droite en appelant à la « démocratie en danger », à s’opposer au gouvernement élu qui fut peint sous les traits de la dictature et du fascisme, selon un procédé bien connu dans les pays d’Occident (la reductio ad Hitlerum) quand la gauche à bout de souffle et d’idées cherche à compenser son effondrement idéologique. Le mouvement a commencé en 2023 avec l’opposition à la mise en œuvre de la réforme judiciaire, inspirée par les juges de la Cour suprême et la gauche vaincue aux élections. Ce refus, que ne justifiait pas le résultat des élections, a pris la forme d’un mouvement d’opinion qui occupait la rue à Tel Aviv, le samedi soir, durant des mois, un mouvement aux slogans anarchistes allant jusqu’à appeler à la désobéissance civile, voire, (bien plus grave) à l’élimination du premier ministre. Le mouvement se transforma par la suite, après le 7 octobre et la crise des otages, en mouvement contre la guerre à Gaza, trouvant dans la sauvegarde des otages une cause victimaire qui redéfinissait l’objectif de la « protestation » et qui se retournait toujours contre Netanyahou accusé de mener la guerre
pour son propre intérêt politicien.
Gageons que, dès aujourd’hui, la « protestation » va servir d’autres causes – mais au fond toujours la même – lors des élections qui doivent se dérouler cette année.
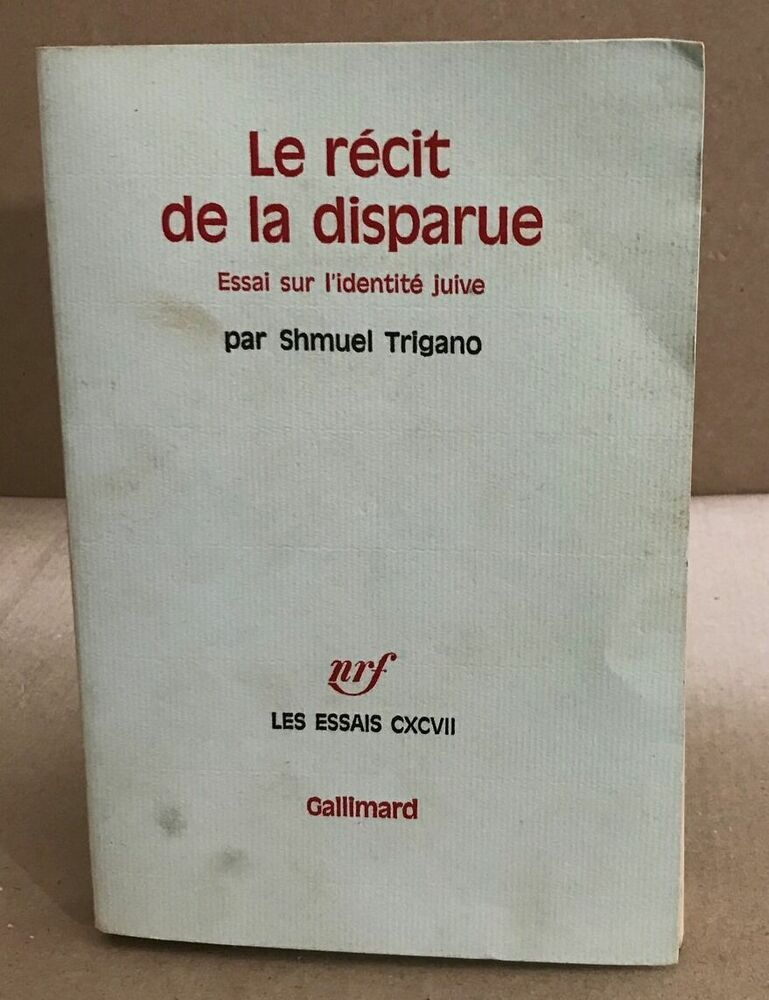
Pour approfondir la problématique du rahamim, cf. S. Trigano «Le récit de la disparue, essai sur l’identité juive », 1977, (Gallimard, Folio)
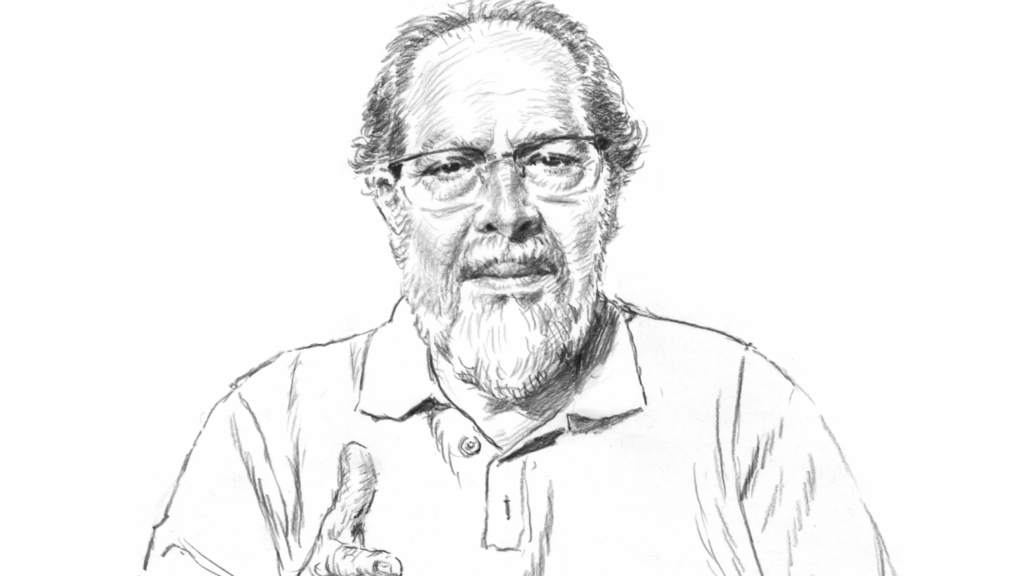
© Shmuel Trigano, Professeur émérite des Universités
[1] Hakol shafit
[2] Exactement ce que le juge Barak a défini très récemment de « dictature » mais en en accusant… le gouvernement Netanyahou !


Excellente mise au point.
Je me permets de renvoyer sur ce sujet (et notamment sur la vision du monde totalitaire du juge Barak) à mon exposé sur la nécessaire réforme judiciaire, Quelle démocratie pour Israël? Pouvoir du peuple ou pouvoir des juges?
Tout à faut d’accord !
Je voudrais cependant compléter en rappelant qu’Aharon Barak, qui fut un étudiant en droit brillant, un professeur ambitieux puis le conseiller juridique du gouvernement Rabin en 1975, théorisa dès les années 1975 SA conception du droit qu’il énonça ainsi : « En tant que juristes, nous ne sommes pas limités à l’interprétation ou à l’application du droit existant… Nous sommes les architectes du changement social. Nous avons les aptitudes nécessaires pour construire un système juridique meilleur et plus juste. Nous ne voyons pas notre rôle comme se limitant à la technique juridique mais comme incluant celui de politique juridique. »
Autrement dit, dans la conception d’Aharon Barak, le rôle du juge est comparable à celui d’un despote éclairé montrant la voie à suivre au peuple et lui disant le droit. Une conception militante et hyperactiviste venue aussi des Etats-Unis à l’exemple de la juge Ruth Bader-Ginzburg.
Cette conception très particulière du droit (où le juge n’a d’ailleurs aucun compte à rendre à personne) est mise en œuvre très rapidement par Aharon Barak, conseiller juridique du gouvernement Rabin où il força le Premier Ministre Rabin à démissionner en 1977 (pour une « affaire » de compte en banque aux Etats-Unis de Mme Rabin, ce qui n’était pas illégal), amenant au pouvoir Menahem Begin et le Likoud. On rappellera également que c’est Aharon Barak, toujours conseiller juridique cette fois du gouvernement Begin, présent dans les discussions de Camp David en 1977-1978, qui imposa la question « palestinienne » OLP, alors que l’Egypte ne demandait rien (d’autant que l’OLP considérait les accords de paix israélo-égyptiens comme une trahison). Enfin, dès 1992, à la Cour Suprême, puis en 1995 comme Président de la Cour suprême, il instaurera une « Révolution Constitutionnelle » (le terme est de lui) encore en vigueur aujourd’hui.
On ne peut donc comprendre la réforme juridique initiée depuis 2023 par le gouvernement Netanyahou en ignorant comment la Cour Suprême agissait auparavant. De 1948 à 1992, pour se prononcer, la Cour Suprême examinait la justiciabilité, c’est-à-dire les limites objectives du droit (sachant que tout n’était pas justiciable) et l’intérêt à agir (le requérant a-t-il subi un préjudice ?). C’est ainsi que jusqu’en 1992, sur la base de ces deux critères, la Cour Suprême limitait ses interventions et refusa même de se prononcer sur des sujets trop clivants politiquement dans la société israélienne, par exemple la nomination d’un premier ambassadeur d’Allemagne en Israël, les « réparations » allemandes ou même sur la conscription des étudiants de Yechivot (arrêt Resler, 1970). La Révolution Constitutionnelle d’Aharon Barak (pour qui « le monde est rempli de droit ») a introduit une très grande insécurité juridique et des bouleversements, par exemple dans l’interprétation des contrats (arrêt Aproprim 1995) ou dans l’interventionnisme politique, notamment sur la nomination d’un chef d’état-major en pleine guerre, alors que le Premier Président de la Cour Suprême, le juge Zamoura, insistait en 1948 sur la séparation des pouvoirs, puisque, disait-il, « la Cour Suprême n’a pas vocation à empiéter sur le domaine du législateur ».
La réforme juridique du gouvernement de coalition de droite est donc une contre-révolution destinée à rééquilibrer les pouvoirs. Tous ceux qui parlent volontiers de « coup d’Etat » à propos de cette réforme et qui ne connaissant rien (par ignorance ou idéologie) à la révolution de la Cour Suprême opérée par Aharon Barak doivent sûrement considérer que quand la Gauche fait main basse sur lé démocratie, ce n’est pas un problème, alors que cette problématique existe peu ou prou, non seulement en Israël mais dans toutes les démocraties occidentales, à savoir : gouvernement du peuple ou gouvernement des juges.
On lira avec profit : Quelle démocratie pour Israël ? Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges ? de Pierre Lurçat
J’ai tellement apprécié cet article !! je lai imprimé pour le lire encore et encore. Cette opposition du « Tous » et du « UN » !! ce rapprochement de nos textes de la hala’ha qui parle tant et tant de la justice et du justiciable dans nos textes !!
Tout ce texte cher Shmuel est l’un de vos Grands textes qui fera référence !! Merci merci pour ce rayon de lumière ; avec vous penser et réfléchir existe encore !!!!
Tout est si nébuleux et sombre ici !
josiane
Aharon Barak (au bas mot) adepte de cette « juristocrassie » qui vise à planter partout, dans les rouages du pays, les graines « goschistes » qui détruisent l’esprit du judaïsme, pour empêcher la droite de diriger le pays.
Nous avons à peu pres le meme principe de justice en France, (syndicat de la magistrature de gauche) qui rendent la justice en fonction de leur ideologie, (la fameuse « harangue d’Oswald Baudot) et les divers institutions, conseils d’etat, conseils constitutionnel qui bloquent à peu prés toutes les lois votés par les députés et puis toutes les administrations principales à gauche toute et vous avez la un pays complètement sclérosé.