« Celui qui croit que le passé est révolu n’a encore rien compris à la mécanique de la haine. » Jean Améry
2025 aura marqué un basculement psychologique : l’antisémitisme n’est plus seulement une résurgence — il prend la forme d’un tsunami social, multi-couches, banal, contagieux, et de plus en plus décomplexé. Le choc ne vient pas seulement du nombre d’actes, mais de leur nature : on est passé, dans trop d’endroits, de l’insulte au ciblage, du ciblage à la violence, de la violence à l’acceptabilité.
Et cette acceptabilité est la vraie défaite.
Les attaques violentes : le retour du meurtre « parce que juif »
Un marqueur tragique de 2025 est le retour, dans des démocraties occidentales, de l’attaque de masse explicitement antisémite.
- Sydney (Bondi Beach, 14 décembre 2025) : une célébration de Hanoucca visée, une attaque qualifiée de terroriste, des morts, des blessés, une communauté frappée en plein rite et en pleine joie — c’est précisément cela, l’antisémitisme : tuer des gens pour ce qu’ils sont, pas pour ce qu’ils font.
- Manchester (2 octobre 2025, Yom Kippour) : un lieu de culte, une fête religieuse, une tentative de massacre, et la démonstration glaçante que l’antisémitisme n’a besoin d’aucun “contexte” local pour frapper : il suffit d’un symbole, d’une kippa, d’une porte de synagogue.
- France : l’agression d’un rabbin (Orléans) rappelle que la haine ne se contente plus de tags : elle vise les corps, et même les enfants présents.
- Italie : l’agression d’un père juif et de son fils près de Milan — déclenchée par la simple visibilité religieuse — montre la mécanique européenne : l’humiliation, puis l’attroupement, puis la violence.
Ce que 2025 réinstalle, c’est une évidence que l’Europe croyait avoir “désapprise” : le Juif redevient une cible narrative, puis une cible sociale, puis une cible physique.
Universités : la fabrique de la « cause » et la normalisation du stigmate
Les universités jouent un rôle particulier : elles ne sont pas seulement un théâtre d’incidents, elles deviennent parfois un incubateur moral, où l’on réapprend à haïr en se croyant vertueux.
En France, des enquêtes et procédures ont visé des faits (saluts nazis, stéréotypes antisémites, incidents répétés) montrant que l’antisémitisme peut aussi revenir par les marges radicalisées, nourries d’une culture politique et numérique où le symbole nazi devient une provocation “ironique”, donc excusable, donc répétable. Et quand une grande institution doit suspendre un cours après des propos jugés antisémites, ce n’est pas un “accident de communication” : c’est le signe que le cadre a cédé.
Le mécanisme est désormais classique :
- On remplace le mot “Juif” par “sioniste” (ou l’inverse, selon les moments) ;
- On élargit : “Israéliens”, “ceux qui soutiennent Israël”, “ceux qui ne dénoncent pas assez” ;
- On conclut : exclusion sociale, intimidation, auto-censure, peur. Et la peur, sur un campus, est une défaite civilisationnelle.
Rues d’Europe : la foule comme alibi, le slogan comme arme
L’année 2025 a vu se multiplier les scènes où l’hostilité contre les Juifs se dissout dans la masse, protégée par la foule : “ce n’est pas de la haine, c’est une cause”.
Le tournant est visible quand des forces de police jugent nécessaire d’endurcir leur doctrine face à des slogans considérés comme incitatifs ou menaçants, précisément parce que “les mots ont des conséquences”.
Ce n’est pas le droit de manifester qui est en cause. C’est la dérive suivante :
- La rue devient tribunal ;
- Le slogan devient preuve ;
- L’intimidation devient “militantisme” ;
- Et la cible juive devient “dommage collatéral”.
Boycott : la vieille recette de l’exclusion recyclée en « morale publique »
Le boycott, quand il vise indistinctement “les Israéliens” — et, par glissement, les Juifs — n’est pas une opinion : c’est une technique sociale. Dans l’histoire européenne, elle a toujours eu le même effet : isoler, désigner, préparer.
Le symbole est puissant quand des institutions médiatiques annoncent un boycott d’un événement culturel au motif de la présence d’Israël. Même lorsque l’intention se veut politique, l’effet social est évident : on réintroduit l’idée qu’une présence juive/Israélienne est une souillure.
Le drame, c’est que le boycott moderne se présente comme éthique, donc il s’autorise tout :
- Refuser un artiste “par nationalité” ;
- Refuser un chercheur “par origine” ;
- Refuser un étudiant “par suspicion d’opinion”. Ce n’est plus un débat : c’est une mise à l’écart.
La « complicité » des États : rarement un ordre, souvent une tolérance
France, Espagne, Irlande. Le mot “complicité” choque — mais il désigne souvent quelque chose de plus banal et plus grave à la fois : la tolérance institutionnelle.
Ce n’est pas toujours “l’État qui veut”. C’est parfois :
- L’État qui n’ose pas nommer (par peur de perdre une partie de l’opinion) ;
- L’État qui relativise (“contexte”, “tensions”) ;
- L’État qui sur-régule le langage sauf quand il s’agit des Juifs ;
- L’État qui laisse prospérer une culture publique où l’on peut frôler l’incitation sans sanction.
Et quand, dans le même temps, on réaffirme solennellement “la lutte contre l’antisémitisme”, le citoyen voit la dissonance : beaucoup de discours, trop peu d’actes — ou trop tard.
“Après la Shoah, l’antisémitisme devait mourir” : l’illusion qui se dissipe
L’idée que la Shoah aurait “vacciné” l’Europe était une erreur de diagnostic.
La Shoah n’a pas supprimé l’antisémitisme : elle l’a contraint. Elle l’a rendu honteux, donc plus subtil. Et quand la honte s’efface, les masques tombent.
Ce que 2025 révèle, ce n’est pas un surgissement spontané : c’est un déverrouillage. Un retour du permis de haïr, à condition de porter le bon costume rhétorique.
Les Juifs ont-ils un avenir en France ?
Une question tragique au regard de ce qu’ils ont fait de la France — et de ce que la France leur a fait
Poser cette question en 2025 n’est pas une provocation. C’est un constat historique devenu angoisse existentielle. Car s’il est un paradoxe français, il est là : aucun autre pays européen n’a autant reçu des Juifs, et aucun ne les a autant trahis à répétition.
La France façonnée aussi par les Juifs
La présence juive en France n’est pas périphérique. Elle est constitutive.
Sur le plan intellectuel et culturel, la France moderne s’est construite dans un dialogue permanent entre universalisme chrétien, humanisme renaissant et pensée juive. Dès Montaigne, la tolérance, le doute, la pluralité des vérités irriguent la pensée française. L’influence juive n’est pas toujours visible, mais elle est là, dans cette manière française de penser contre soi-même, d’introduire l’altérité au cœur de la raison.
Dans la littérature, les Juifs de France ont porté l’exigence morale, l’ironie tragique, la lucidité sans illusion : de l’affaire Dreyfus à la Shoah, ils ont souvent été les sentinelles du réel, ceux qui rappellent que la civilisation est fragile.
Dans la science, la médecine, la recherche, l’université, les Juifs ont été surreprésentés, non par privilège, mais par une culture du savoir, de l’étude, de la transmission — parfois la seule richesse que l’histoire leur laissait.
Dans la politique et l’économie, l’exemple est éclatant avec Jacques Rueff, architecte du redressement économique de 1958, dont la rigueur et la vision ont sauvé la France du chaos monétaire. Rueff, comme tant d’autres, n’a jamais agi en tant que Juif, mais en tant que Français — ce qui n’a jamais empêché qu’on le ramène à son origine quand le vent tournait.
Les Juifs ont contribué à l’essence même de la France :
- L’universalisme,
- La raison critique,
- La primauté du droit,
- La méfiance envers les foules et les certitudes,
- Le refus de l’idolâtrie politique. Et pourtant.
Une histoire de rejets cycliques, malgré l’apport
Cette contribution n’a jamais protégé les Juifs de France. Ni les expulsions médiévales.
Ni Louis IX, la rouelle, les massacres sanctifiés.
Ni l’Affaire Dreyfus, qui révéla une République prête à sacrifier un innocent pour sauver son armée et ses mythes.
Ni la haine des années 1930, parfaitement française, intellectuelle, mondaine, “distinguée”. Ni le Statut des Juifs, rédigé sans contrainte allemande.
Ni les rafles, les déportations, la collaboration administrative. Ni Auschwitz. Ni Josef Mengele.
Pire encore : l’après-guerre n’a pas guéri. Elle a recouvert.
À peine vingt ans plus tard, celui qui incarnait la Résistance, Charles de Gaulle, reprend des thèmes immémoriaux : peuple d’argent, sûr de lui et dominateur, double allégeance. Ce ne fut pas un dérapage : ce fut un signal. Le masque était remis, mais la matrice restait intacte.
Depuis 2000 : la déferlante
À partir des années 2000, le cycle s’accélère :
- Agressions,
- Meurtres,
- Écoles sous protection,
- Synagogues barricadées,
- Juifs sommés de se taire, de s’excuser, de se cacher.
Puis vient le prétexte de la guerre, comme toujours. Comme si l’antisémitisme avait besoin d’un alibi moral pour se libérer.
Le pogrom du 7 octobre — barbarie absolue, viols, mutilations, meurtres de masse — aurait dû provoquer un sursaut moral universel. Il n’a produit qu’un renversement obscène : les victimes sont devenues suspectes, et la barbarie relativisée.
Et c’est là que se joue l’impardonnable.
La complicité d’État : quand l’histoire bégaie
Lorsque Emmanuel Macron relativise, temporise, contextualise, met sur le même plan l’horreur terroriste et la défense d’un État attaqué, il ne fait pas de la diplomatie : il réactive un vieux logiciel français. Celui où l’on pense que calmer la rue vaut mieux que protéger une minorité. Celui où l’on croit que les Juifs peuvent encore attendre, comprendre, faire preuve de retenue.
C’est cela, la complicité d’État moderne : non pas l’ordre de persécuter, mais le refus de nommer, le refus de trancher, le refus d’assumer le prix politique de la justice.
Peut-on encore pardonner ?
La question n’est plus morale, elle est vitale.
Combien de fois un peuple peut-il être trahi par un pays qu’il a servi, aimé, défendu, pensé, enrichi ? Combien de cycles faut-il avant d’admettre que l’illusion d’une normalisation définitive était une erreur ?
La vérité est sanglante, et beaucoup de Juifs de France le savent déjà intimement : ils ne sont tolérés que tant qu’ils sont invisibles, silencieux, utiles et coupables de rien.
Dès qu’ils existent, dès qu’ils se défendent, dès qu’ils refusent de s’excuser d’être vivants — le vieux réflexe revient.
Les Juifs ont-ils encore un avenir en France ?
La question n’est plus : la France aime-t-elle ses Juifs ? Elle ne l’a jamais vraiment fait.
La seule question est désormais : la France est-elle encore capable de les protéger quand cela devient difficile, impopulaire, dangereux politiquement ?
Si la réponse est non, alors l’histoire n’est pas tragique par surprise — elle est tragique par répétition.
Et cette fois, nul ne pourra dire : nous ne savions pas.
Il y a trente ans, cette question paraissait indécente. En 2025, elle devient rationnelle — parce que les paramètres ont changé :
- La violence n’est plus marginale ;
- L’intimidation est redevenue sociale ;
- L’isolement est redevenu “moral” ;
- Et l’État semble parfois plus inquiet des troubles que de la haine qui les nourrit. L’avenir des Juifs en Europe dépendra moins des déclarations que d’un test simple :
Une démocratie est-elle capable de protéger une minorité quand il devient “coûteux” politiquement de la protéger ?
Car c’est là, la définition du courage public.
© Richard Abitbol
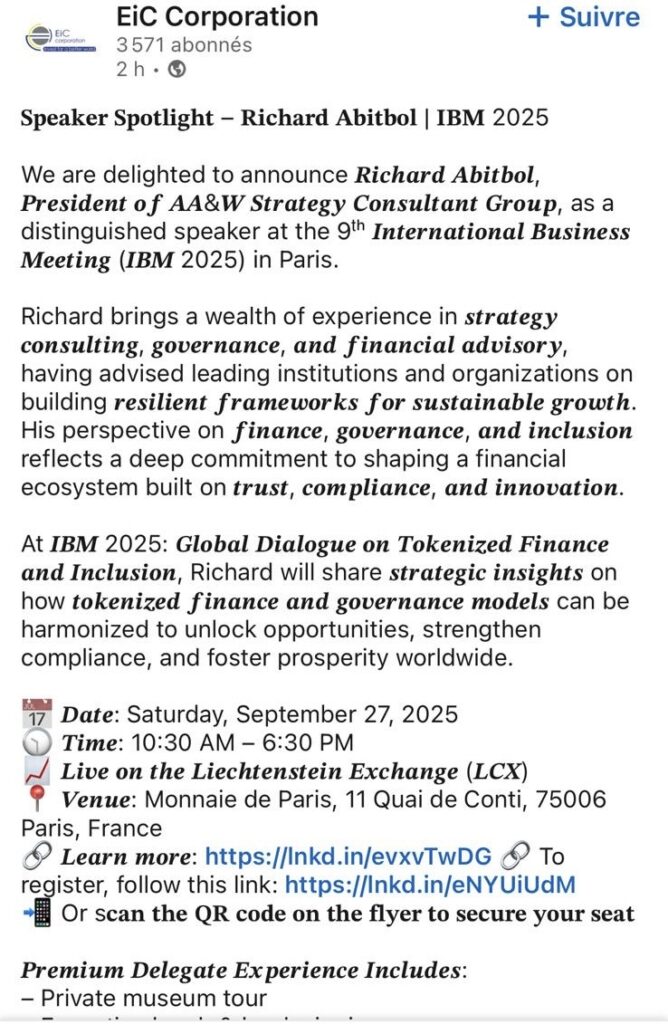


Cher Mr Abitbol , il faut nous pencher ensemble , non pas sur le devenir de la France qui ne fut qu une terre d accueil parmi d autres , mais sur le destin et le cheminement du peuple juif .
Je fais partie des franco israeliens qui ont choisi de rejoindre la route juive sur la terre juive dans la nation juive , aussi ma parole ne sera pas objective , mais les multiples questionnements et circonvolutions intellectuelles sur un hypothetique » futur juif » en France me semblent relever d une vision erronée .
Ou se trouve la place naturelle d un juif en 2025 alors que les miracles s enchainent pour nous enraciner a nouveau sur les trace de nos ancetres communs ?