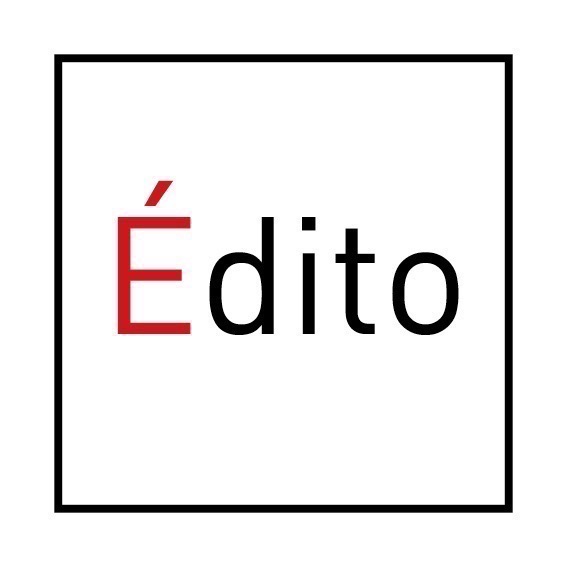
« Les mots sont des armes plus redoutables que les canons, car ils tuent avant que la guerre ne commence ». — Édouard Herriot (discours de 1935)
« Quand les gouvernements perdent la confiance du peuple, ils invoquent la patrie en danger ».
— Honoré de Balzac
Il est des mots qui résonnent comme des tambours : ils ne disent pas la guerre, ils l’appellent. Lorsque le chef d’état-major des armées françaises déclare que « l’armée doit être prête à un choc avec la Russie dans trois ou quatre ans », il ne parle pas seulement en militaire. Il parle, sans doute malgré lui, en instrument politique. Et c’est là tout le danger.
Car derrière cette mise en scène martiale, il y a l’ombre d’un pouvoir finissant — un pouvoir qui, ne sachant plus convaincre, cherche à impressionner. Quand un président arrive à bout de souffle, que sa parole ne passe plus, que la rue gronde, que la jeunesse se détourne, que la majorité s’effrite, il reste toujours un ultime ressort : le fracas du monde.
L’histoire française est coutumière de ces sursauts de grandeur mimée, où l’on brandit l’étendard de la guerre pour faire oublier la petitesse du quotidien.
1G14, 1G3G, 1G56… ET MAINTENANT ?
À chaque fois que la France a perdu pied, elle a cru se retrouver en se cherchant un ennemi. En 1914, les discours de mobilisation furent applaudis comme des promesses de gloire : quatre ans plus tard, dix millions de morts. En 1939, on crut laver la honte de Munich par les armes : ce fut l’effondrement. En 1956, l’expédition de Suez devait redonner du lustre à la IVe République : elle précipita sa chute. Chaque fois, le pouvoir croyait reprendre la main par le sabre, et chaque fois, c’est le sabre qui lui échappa des mains.
L’ARMÉE COMME DÉCOR D’AUTORITE
Il faut dire les choses clairement : la France d’aujourd’hui n’est pas menacée d’une invasion russe. Elle est menacée d’une crise de sens. Et lorsque le chef de l’État se présente en « chef de guerre », il ne parle pas à Moscou : il parle à Paris, à ses électeurs, à son histoire. Il tente de se réinscrire dans le roman national, celui du général en uniforme, du président protecteur, du symbole debout.
Mais cette posture n’est pas de la stratégie : c’est du théâtre. Elle sert à habiller le vide intérieur d’une gravité empruntée, à dissimuler l’impuissance sociale derrière une rhétorique virile, et à faire oublier la dissolution de l’autorité politique en ressuscitant l’autorité militaire.
LA GUERRE DES MOTS PRÉCÈDE TOUJOURS LA GUERRE DES HOMMES
On feint de se préparer à la guerre pour mieux la conjurer, dit-on. C’est faux. Les mots répétés finissent toujours par engendrer la réalité qu’ils décrivent. La guerre de 1914 n’a pas éclaté un matin d’août : elle a été fabriquée, patiemment, par des décennies de discours enfiévrés, d’exercices militaires « préventifs », et d’honneurs nationaux brandis comme des glaives. Nous entrons aujourd’hui dans la même mécanique : la logique du pire par anticipation.
Et pourtant, la grandeur d’un chef d’État n’est pas de menacer, mais de prévenir. La véritable autorité, c’est celle du silence efficace — celle qui agit sans se montrer, qui prépare sans proclamer. L’armée doit être prête, bien sûr. Mais la République, elle, doit être sage.
FAIRE ET SE TAIRE
Le drame de la France contemporaine, c’est qu’elle confond communication et action. Elle croit qu’en déclarant, elle agit ; qu’en dramatisant, elle gouverne ; qu’en invoquant la guerre, elle retrouve l’unité perdue. Mais le peuple, lui, n’est pas dupe. Il sait qu’un pouvoir qui parle de guerre sans avoir réglé la paix intérieure n’a plus qu’un objectif : exister encore un peu.
Le bruit des bottes n’est pas toujours celui des armées : parfois, ce sont les pas fébriles du pouvoir qui s’en va.
LA PAROLE SANS ÉCHO : ǪUAND LA FRANCE PARLE DANS LE VIDE
La diplomatie française n’est plus ce qu’elle fut : elle mime la grandeur sans en avoir les moyens, ni la cohérence. Elle ne rayonne plus, elle clignote. Ses sommets se succèdent comme des cérémonies d’auto-célébration où l’on s’écoute parler entre convaincus, pendant que le monde, lui, s’organise ailleurs.
Le dernier Forum pour la Paix de Paris, tenu les 29 et 30 octobre, en a offert le spectacle le plus pathétique : aucune annonce, aucun écho, aucune figure majeure. Les caméras absentes ont confirmé ce que tous savaient déjà : plus personne ne prête attention à la voix de la France.
Autrefois, un mot du Quai d’Orsay pouvait faire trembler une capitale ou infléchir une négociation. Aujourd’hui, il ne déclenche plus qu’un haussement d’épaules poli. L’Afrique, longtemps considérée comme son pré carré, s’est détournée d’elle avec fracas. Le Sahel lui échappe, ses ambassades ferment, ses bases sont expulsées, et ses partenaires historiques se tournent vers la Chine, la Russie, la Turquie — ou simplement vers eux-mêmes.
Au Proche-Orient, la France ne pèse plus rien. Elle a voulu être médiatrice universelle et se retrouve inaudible, prisonnière de ses ambiguïtés morales et de ses postures diplomatiques à géométrie variable.
En Asie, elle amuse. En Amérique, elle fait sourire. Même l’Europe la regarde avec méfiance, comme un vieil oncle moralisateur qu’on invite par devoir mais qu’on n’écoute plus.
La France voulait être la conscience du monde : elle n’est plus que sa note de bas de page. Elle s’est perdue à force de parler de valeurs sans en incarner aucune, de défendre des principes qu’elle trahit au premier intérêt, et de confondre diplomatie et communication.
Faire le buzz est devenu son dernier attribut de puissance. Là où autrefois elle bâtissait des équilibres, elle se contente aujourd’hui de provoquer des polémiques. Et pendant qu’elle parade en tribune, d’autres écrivent l’histoire — sans elle, et souvent contre elle.
La France n’est pas haïe : elle est oubliée.
Et dans le concert des nations, l’oubli est une mort plus humiliante encore que la défaite.
© Richard Abitbol